Pour démarrer l’été, je vous propose de découvrir de quoi vous détendre sur les plages avec un peu de lecture. Comme je voulais un peu avancer dans la lecture de ce que je vous présente ci-après avant d’en parler, la sortie de cet article a pris un peu de retard… Si je vous dis « Subaru », beaucoup vont bien sûr me répondre « voiture de sport ».  Mais ce n’est pas ce dont je veux vous parler aujourd’hui (ceci n’est pas un blog sur les sports mécaniques…). « Subaru », c’est le nom d’une série de mangas dessinés et écrits par Masahito Soda. Le titre complet est « Subaru, danse vers les étoiles » et la série est composée de 11 épisodes dont le premier est sorti en France en 2006 aux éditions Delcourt. C’est le seul manga consacré à la danse que je connaisse et il méritait donc bien un article complet dans le blog UltraDanse.com !
Mais ce n’est pas ce dont je veux vous parler aujourd’hui (ceci n’est pas un blog sur les sports mécaniques…). « Subaru », c’est le nom d’une série de mangas dessinés et écrits par Masahito Soda. Le titre complet est « Subaru, danse vers les étoiles » et la série est composée de 11 épisodes dont le premier est sorti en France en 2006 aux éditions Delcourt. C’est le seul manga consacré à la danse que je connaisse et il méritait donc bien un article complet dans le blog UltraDanse.com !
La base de l’histoire est la suivante. Subaru est une petite fille japonaise (et, comme souvent dans les mangas, elle n’a pas le type japonais) mais, contrairement aux autres enfants de son âge, elle prend rarement le temps de jouer. À la fin de ses cours, elle se rend à l’hôpital où elle retrouve son frère, atteint d’une tumeur au cerveau et dont l’état empire petit à petit. Chaque jour, la petite Subaru danse pour redonner le sourire à son frère, mais la danse va rapidement prendre une importance primordiale dans la vie de la petite fille, surtout après le décès de celui-ci. Cette danse va lui permettre d’extérioriser tout son mal-être. Au fil des différents tomes du manga, on retrouve une Subaru qui grandit. Devenue adolescente, elle ne jure plus que par la danse et espère un jour devenir professionnelle. Mais la route est encore longue…
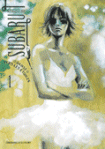


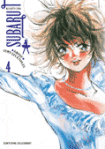





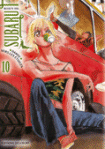
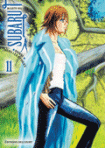
 Les 11 volumes de la série s’enchaînent dans une histoire continue (il vaut donc mieux lire tout cela dans l’ordre). D’ailleurs, les chapitres sont numérotés en continu sur l’ensemble de la série : on commence au chapitre 1 au début du tome 1 et on finit au chapitre 123 à la fin du tome 11. La danse dont on parle dans ce manga tourne à la base autour de la danse classique, mais Subaru se met aussi très bien au hip-hop et à la danse contemporaine (tome 3). Bien entendu, comme tout manga qui se respecte, la lecture s’effectue à l’envers d’un livre traditionnel Européen : on commence à la « dernière page » et on va vers la « première ». Lorsqu’on n’est pas habitué, c’est tout d’abord déstabilisant, car on a tendance à reprendre une lecture de gauche à droite, mais on s’y fait finalement très bien. Par ailleurs, les dessins sont en noir et blanc et réalisés d’un trait très noir, ce qui confère au manga une ambiance bien particulière et assez « sérieuse ».
Les 11 volumes de la série s’enchaînent dans une histoire continue (il vaut donc mieux lire tout cela dans l’ordre). D’ailleurs, les chapitres sont numérotés en continu sur l’ensemble de la série : on commence au chapitre 1 au début du tome 1 et on finit au chapitre 123 à la fin du tome 11. La danse dont on parle dans ce manga tourne à la base autour de la danse classique, mais Subaru se met aussi très bien au hip-hop et à la danse contemporaine (tome 3). Bien entendu, comme tout manga qui se respecte, la lecture s’effectue à l’envers d’un livre traditionnel Européen : on commence à la « dernière page » et on va vers la « première ». Lorsqu’on n’est pas habitué, c’est tout d’abord déstabilisant, car on a tendance à reprendre une lecture de gauche à droite, mais on s’y fait finalement très bien. Par ailleurs, les dessins sont en noir et blanc et réalisés d’un trait très noir, ce qui confère au manga une ambiance bien particulière et assez « sérieuse ».
Lorsqu’on regarde ce qui existe dans le domaine de la BD sur le thème de la danse, on a assez peu de choix. J’ai d’ailleurs écrit un article sur le sujet ici il y a quelques mois. On a en particulier, « Studio Danse », une BD humoristique, « Danse! », l’adaptation de la série de livres du même nom, « Danseuse » qui n’a pour l’instant qu’un seul tome. Toutes ces bandes dessinées s’adressent à un public très large allant des enfants aux jeunes étudiant(e)s en passant par les adolescents. Dans le cas de « Subaru », je dirais qu’il faut avoir déjà une certaine maturité pour le lire et que son public commence à l’adolescence. En effet, les sujets qui y sont traités sont parfois difficiles (la mort, les rivalités, l’abandon de sa famille, l’influence que l’on a sur les autres, etc.) et cela change décidément des petites histoires légères des BD citées plus haut et des mièvreries sucrées qui sont souvent écrites pour les préadolescentes aimant la danse classique.
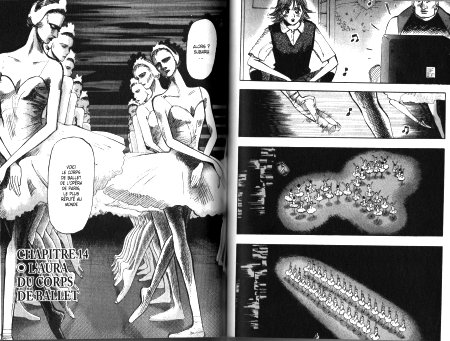 Je dois avouer que l’ambiance créée par l’auteur Masahito Soda est efficace. Autant dans ses dessins que dans son texte. On est petit à petit captivé par l’histoire de cette jeune fille qui ne cesse de progresser en tant que danseuse malgré toutes les épreuves de la vie (et de la scène) qu’elle doit surmonter. On retrouve bien l’esprit manga des dessins animés qui passent à la télévision où les pensées intérieures des personnages sont abondamment exprimées en s’intercalant dans des scènes d’action. La pensée récurrente des personnages regardant Subaru danser est « Mais comment a-t-elle fait pour progresser si vite ? ». A certains moments, comme dans le tome 2, j’ai même eu l’impression de lire un livre traitant d’arts martiaux, car Subaru doit trouver un moyen (que je ne vous dévoilerai pas…) pour prendre conscience des autres danseuses du ballet autour d’elle. L’auteur de ce manga dessine avec réalisme les scènes de danse. Il me semble parfaitement au courant des différents éléments de la danse et est certainement un passionné de danse qui retranscrit certains détails avec précision tant au niveau du trait de ses dessins qu’au niveau de l’état d’esprit général. Ainsi, le lecteur assiste réellement à des scènes de danse très vivantes.
Je dois avouer que l’ambiance créée par l’auteur Masahito Soda est efficace. Autant dans ses dessins que dans son texte. On est petit à petit captivé par l’histoire de cette jeune fille qui ne cesse de progresser en tant que danseuse malgré toutes les épreuves de la vie (et de la scène) qu’elle doit surmonter. On retrouve bien l’esprit manga des dessins animés qui passent à la télévision où les pensées intérieures des personnages sont abondamment exprimées en s’intercalant dans des scènes d’action. La pensée récurrente des personnages regardant Subaru danser est « Mais comment a-t-elle fait pour progresser si vite ? ». A certains moments, comme dans le tome 2, j’ai même eu l’impression de lire un livre traitant d’arts martiaux, car Subaru doit trouver un moyen (que je ne vous dévoilerai pas…) pour prendre conscience des autres danseuses du ballet autour d’elle. L’auteur de ce manga dessine avec réalisme les scènes de danse. Il me semble parfaitement au courant des différents éléments de la danse et est certainement un passionné de danse qui retranscrit certains détails avec précision tant au niveau du trait de ses dessins qu’au niveau de l’état d’esprit général. Ainsi, le lecteur assiste réellement à des scènes de danse très vivantes.
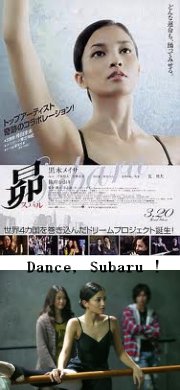 Il peut aussi être intéressant de savoir que cette série de mangas a été adaptée au cinéma dans un film nommé « Dance, Subaru ! » en 2009, réalisé par Chi-Ngai Lee et produit par William Kong (celui qui est derrière « Tigre et Dragon » ou encore « Le secret des poignards volants », deux films à l’univers graphique très réussi et que j’ai personnellement bien aimés) avec, dans le rôle principal, la (vraie) danseuse Meisa Kuroki. Cette adaptation, sortie au Japon, s’éloigne un peu des 11 volumes du manga, mais le thème général de l’histoire est le même. Les scènes de danse sont bonnes, mais il me semble qu’elles sont moins efficaces que celles décrites dans les livres. Le DVD existe (vo, sous-titres en anglais), mais il n’est pas vendu en France. Toutefois, pour vous mettre l’eau à la bouche, voici la bande-annonce de ce film, issue de Youtube. Les sous-titres vous aideront probablement à saisir de quoi il s’agit.
Il peut aussi être intéressant de savoir que cette série de mangas a été adaptée au cinéma dans un film nommé « Dance, Subaru ! » en 2009, réalisé par Chi-Ngai Lee et produit par William Kong (celui qui est derrière « Tigre et Dragon » ou encore « Le secret des poignards volants », deux films à l’univers graphique très réussi et que j’ai personnellement bien aimés) avec, dans le rôle principal, la (vraie) danseuse Meisa Kuroki. Cette adaptation, sortie au Japon, s’éloigne un peu des 11 volumes du manga, mais le thème général de l’histoire est le même. Les scènes de danse sont bonnes, mais il me semble qu’elles sont moins efficaces que celles décrites dans les livres. Le DVD existe (vo, sous-titres en anglais), mais il n’est pas vendu en France. Toutefois, pour vous mettre l’eau à la bouche, voici la bande-annonce de ce film, issue de Youtube. Les sous-titres vous aideront probablement à saisir de quoi il s’agit.
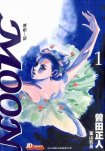 Si vous voulez acquérir l’intégralité des 11 volumes de « Subaru, danse vers les étoiles », il se peut que vous ne puissiez pas le faire chez un seul et unique vendeur. Personnellement, j’ai dû jongler entre divers vendeurs en ligne (et même eBay pour l’un des tomes) afin d’obtenir toute la série rapidement. Néanmoins, je ne regrette pas mon achat (chaque livre coûte environ 7,50 euros) et, si vous êtes amateur/trice de mangas et passionné(e) de danse de surcroît, je vous recommande cette série de « Subaru, danse vers les étoiles ». Enfin, si vous n’en avez pas eu assez, vous pourrez aussi vous mettre en quête de la suite : « Subaru 2 : Moon ». Une nouvelle série de mangas par le même auteur encore en cours (8 tomes parus au Japon, dont le dernier sort aujourd’hui) et qui n’a pas encore été traduite en français à ma connaissance.
Si vous voulez acquérir l’intégralité des 11 volumes de « Subaru, danse vers les étoiles », il se peut que vous ne puissiez pas le faire chez un seul et unique vendeur. Personnellement, j’ai dû jongler entre divers vendeurs en ligne (et même eBay pour l’un des tomes) afin d’obtenir toute la série rapidement. Néanmoins, je ne regrette pas mon achat (chaque livre coûte environ 7,50 euros) et, si vous êtes amateur/trice de mangas et passionné(e) de danse de surcroît, je vous recommande cette série de « Subaru, danse vers les étoiles ». Enfin, si vous n’en avez pas eu assez, vous pourrez aussi vous mettre en quête de la suite : « Subaru 2 : Moon ». Une nouvelle série de mangas par le même auteur encore en cours (8 tomes parus au Japon, dont le dernier sort aujourd’hui) et qui n’a pas encore été traduite en français à ma connaissance.
Comme tous les ans, je ralentis le rythme du blog durant l’été (du reste, j’avais déjà un peu commencé en juin…) et je vous donne donc rendez-vous à la rentrée de septembre. Passez un bon été où il se peut que j’écrive néanmoins quelques lignes dans ce blog !

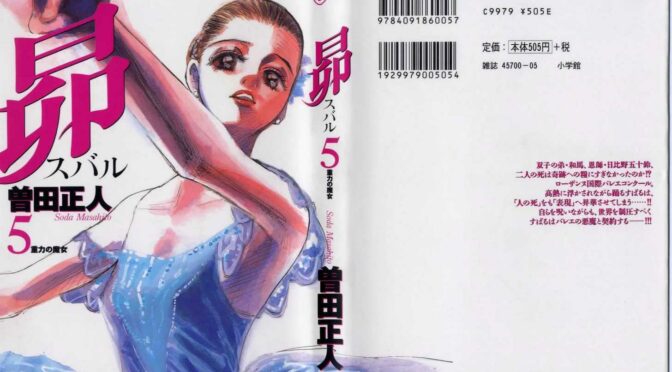

 Il y a un certain nombre de modes d’expression que l’on n’imagine pas toujours associer au monde de la danse. Certaines disciplines s’apparentent en effet aussi bien au monde du sport qu’à celui de la danse. L’exemple le plus évident est le patinage artistique (dont je parlerai un jour ici), mais il y a aussi la gymnastique rythmique (GR, anciennement appelée GRS). Ce sont des « disciplines sportives à composante artistique ». Personnellement, je trouve que le rock acrobatique pourrait aussi figurer dans cette catégorie. Dans cet article, je vais vous présenter un domaine auquel que, malgré son nom, l’on n’envisage pas souvent comme une danse: la pole dance.
Il y a un certain nombre de modes d’expression que l’on n’imagine pas toujours associer au monde de la danse. Certaines disciplines s’apparentent en effet aussi bien au monde du sport qu’à celui de la danse. L’exemple le plus évident est le patinage artistique (dont je parlerai un jour ici), mais il y a aussi la gymnastique rythmique (GR, anciennement appelée GRS). Ce sont des « disciplines sportives à composante artistique ». Personnellement, je trouve que le rock acrobatique pourrait aussi figurer dans cette catégorie. Dans cet article, je vais vous présenter un domaine auquel que, malgré son nom, l’on n’envisage pas souvent comme une danse: la pole dance. La particularité de la pole dance, c’est qu’elle nécessite un accessoire essentiel : une barre verticale (« pole » signifie « mât » en anglais). C’est essentiellement accrochée à cette barre de 45 ou 50 mm de diamètre que la danseuse de pole dance évolue en tenue plus ou moins légère. Cette barre a été héritée du temps (dans les années 1920) ou les danseuses en question étaient itinérantes et dansaient sous des tentes (comme au sein des cirques) dont elles réutilisaient les mâts. A l’époque, ces danseuses étaient qualifiées d’exotiques ou d’excentriques (discipline où l’on mettait un peu toutes les formes de danse inclassables ailleurs). Il est vrai que la pole dance est souvent associée au strip-tease, sans doute parce qu’on la rencontre depuis longtemps dans les lieux où les spectacles de strip-tease ou de lapdance ou encore de go-go danseuses sont présentés. Historiquement, la barre verticale a été utilisée comme accessoire secondaire par les jeunes filles qui se dénudaient dans les clubs spécialisés. Peu à peu, certaines d’entre-elles (et d’autres) ont travaillé la technique et élevé la pole dance au rang d’une discipline artistique et sportive où la barre est essentielle et où il ne reste du strip-tease qu’un aspect sexy dans les mouvements et une tenue assez légère. En effet, même si les danseuses restent habillées, leurs vêtements doivent laisser apparaître une bonne surface de peau, car c’est le contact entre la barre et la peau qui contribue au fait que la danseuse tienne en l’air. Dans la plupart des cas, un shorty et un top à manches courtes ou une brassière composent la garde-robe minimale. Dans le même ordre d’idée, il n’est pas question de s’enduire de crème hydratante ou d’huile sur avant de danser : la peau ne doit pas glisser, au contraire, elle doit adhérer à la barre (ce qui conduit parfois à des échauffements de peau douloureux lorsqu’on débute…).
La particularité de la pole dance, c’est qu’elle nécessite un accessoire essentiel : une barre verticale (« pole » signifie « mât » en anglais). C’est essentiellement accrochée à cette barre de 45 ou 50 mm de diamètre que la danseuse de pole dance évolue en tenue plus ou moins légère. Cette barre a été héritée du temps (dans les années 1920) ou les danseuses en question étaient itinérantes et dansaient sous des tentes (comme au sein des cirques) dont elles réutilisaient les mâts. A l’époque, ces danseuses étaient qualifiées d’exotiques ou d’excentriques (discipline où l’on mettait un peu toutes les formes de danse inclassables ailleurs). Il est vrai que la pole dance est souvent associée au strip-tease, sans doute parce qu’on la rencontre depuis longtemps dans les lieux où les spectacles de strip-tease ou de lapdance ou encore de go-go danseuses sont présentés. Historiquement, la barre verticale a été utilisée comme accessoire secondaire par les jeunes filles qui se dénudaient dans les clubs spécialisés. Peu à peu, certaines d’entre-elles (et d’autres) ont travaillé la technique et élevé la pole dance au rang d’une discipline artistique et sportive où la barre est essentielle et où il ne reste du strip-tease qu’un aspect sexy dans les mouvements et une tenue assez légère. En effet, même si les danseuses restent habillées, leurs vêtements doivent laisser apparaître une bonne surface de peau, car c’est le contact entre la barre et la peau qui contribue au fait que la danseuse tienne en l’air. Dans la plupart des cas, un shorty et un top à manches courtes ou une brassière composent la garde-robe minimale. Dans le même ordre d’idée, il n’est pas question de s’enduire de crème hydratante ou d’huile sur avant de danser : la peau ne doit pas glisser, au contraire, elle doit adhérer à la barre (ce qui conduit parfois à des échauffements de peau douloureux lorsqu’on débute…). N’oublions pas que la pole dance est désormais une vraie discipline sportive qui est associée à une technique précise. Il ne suffit pas de se déhancher autour d’une barre verticale pour faire de la pole dance. Tout le monde ne peut pas parvenir à tenir en drapeau sur une barre en métal sans un certain entraînement, ni un minimum de connaissances techniques. Inspirée des pompiers qui glissent le long de leur mât pour rejoindre leur véhicule rouge alors que la sirène d’alerte retentir, l’une des figures de base de la famille des « spins » (on tourne autour de la barre, utilisant ainsi la force centrifuge) s’appelle le « Fireman basic ». Elle consiste à s’élancer en tournant autour de la barre avec une main en haut de celle-ci, puis de rassembler les jambes croisées autour de la barre en continuant de tourner. Le mouvement se termine lorsque les pieds touchent le sol et la danseuse se relève calmement en dépliant les jambes avant de redresser son buste. Tout cela se fait sans à-coup de manière sensuelle, comme la plupart des mouvements de pole dance. Dans le même esprit, il y a aussi la « chaise » où la danseuse tourne autour de la barre, les deux jambes du même côté de la barre, fléchies à 90 degrés, comme si elle était assise sur l’une de ces « chaises volantes » que l’on trouve dans les fêtes foraines. Bon nombre de figures de pole dance nécessitent de monter sur la partie supérieure de la barre afin de s’y accrocher et d’effectuer des mouvements ou des positions. C’est, par exemple, le cas de la « planche » où la danseuse tient en position perpendiculaire à la barre, en position quasiment allongée. Dans d’autres figures, comme le « V », la danseuse se tient la tête en bas et les pieds en l’air. Ce type d’inversion est de plus en plus utilisé au fil de l’apprentissage de la pole dance.
N’oublions pas que la pole dance est désormais une vraie discipline sportive qui est associée à une technique précise. Il ne suffit pas de se déhancher autour d’une barre verticale pour faire de la pole dance. Tout le monde ne peut pas parvenir à tenir en drapeau sur une barre en métal sans un certain entraînement, ni un minimum de connaissances techniques. Inspirée des pompiers qui glissent le long de leur mât pour rejoindre leur véhicule rouge alors que la sirène d’alerte retentir, l’une des figures de base de la famille des « spins » (on tourne autour de la barre, utilisant ainsi la force centrifuge) s’appelle le « Fireman basic ». Elle consiste à s’élancer en tournant autour de la barre avec une main en haut de celle-ci, puis de rassembler les jambes croisées autour de la barre en continuant de tourner. Le mouvement se termine lorsque les pieds touchent le sol et la danseuse se relève calmement en dépliant les jambes avant de redresser son buste. Tout cela se fait sans à-coup de manière sensuelle, comme la plupart des mouvements de pole dance. Dans le même esprit, il y a aussi la « chaise » où la danseuse tourne autour de la barre, les deux jambes du même côté de la barre, fléchies à 90 degrés, comme si elle était assise sur l’une de ces « chaises volantes » que l’on trouve dans les fêtes foraines. Bon nombre de figures de pole dance nécessitent de monter sur la partie supérieure de la barre afin de s’y accrocher et d’effectuer des mouvements ou des positions. C’est, par exemple, le cas de la « planche » où la danseuse tient en position perpendiculaire à la barre, en position quasiment allongée. Dans d’autres figures, comme le « V », la danseuse se tient la tête en bas et les pieds en l’air. Ce type d’inversion est de plus en plus utilisé au fil de l’apprentissage de la pole dance.  On devine aisément que ce type de figure est assez physique (la danse est mêlée à l’acrobatie) et il est évident que la phase d’échauffement préalable et celle d’étirement après une séance sont importantes afin d’éviter les accidents.
On devine aisément que ce type de figure est assez physique (la danse est mêlée à l’acrobatie) et il est évident que la phase d’échauffement préalable et celle d’étirement après une séance sont importantes afin d’éviter les accidents. La pole dance développe la musculature (abdos, bras, épaules, cuisses et fessiers en particulier : il suffit de regarder d’un peu plus près les photos agrémentant cet article), la souplesse ce qui en fait un sport complet. Mais l’expression corporelle au sein des mouvements y ajoute un aspect artistique qui se développe également. Bien sûr, si l’on a toutes ces qualités dès le départ, l’apprentissage n’en sera que facilité. Néanmoins, avec la pratique et les progrès, toutes ces qualités se développent chez les pratiquantes qui gagnent généralement ainsi en confiance en soi et en aisance. Certaines disent qu’en « faisant de la pole dance, elles se sentent plus femme. » Vous avez sûrement remarqué que je ne parle que de danseuses ? Et les danseurs ? Il en existe, mais peu (certains d’entre eux se produisent en spectacle dans des cabarets ou des cirques et leurs prestations n’ont pas le même style que celles des femmes). Il est vrai que les danseuses de pole dance qui pratiquent en amateur soit désirent accéder à des compétitions de haut niveau, soit souhaitent simplement se défouler en apprenant un mode d’expression qui pourrait un jour séduire leur homme. Je terminerai par citer une autre forme d’utilisation des barres verticales par les Chinois (les mâts chinois circassiens) essentiellement sur scène et par les Indiens (dont le sport autour d’un mât en bois s’appelle le « mallakhamb »). Dans ce contexte, il n’est question que de performance, de spectacle, d’acrobatie et de gymnastique et on ne parle plus de séduction, ni de danse du reste.
La pole dance développe la musculature (abdos, bras, épaules, cuisses et fessiers en particulier : il suffit de regarder d’un peu plus près les photos agrémentant cet article), la souplesse ce qui en fait un sport complet. Mais l’expression corporelle au sein des mouvements y ajoute un aspect artistique qui se développe également. Bien sûr, si l’on a toutes ces qualités dès le départ, l’apprentissage n’en sera que facilité. Néanmoins, avec la pratique et les progrès, toutes ces qualités se développent chez les pratiquantes qui gagnent généralement ainsi en confiance en soi et en aisance. Certaines disent qu’en « faisant de la pole dance, elles se sentent plus femme. » Vous avez sûrement remarqué que je ne parle que de danseuses ? Et les danseurs ? Il en existe, mais peu (certains d’entre eux se produisent en spectacle dans des cabarets ou des cirques et leurs prestations n’ont pas le même style que celles des femmes). Il est vrai que les danseuses de pole dance qui pratiquent en amateur soit désirent accéder à des compétitions de haut niveau, soit souhaitent simplement se défouler en apprenant un mode d’expression qui pourrait un jour séduire leur homme. Je terminerai par citer une autre forme d’utilisation des barres verticales par les Chinois (les mâts chinois circassiens) essentiellement sur scène et par les Indiens (dont le sport autour d’un mât en bois s’appelle le « mallakhamb »). Dans ce contexte, il n’est question que de performance, de spectacle, d’acrobatie et de gymnastique et on ne parle plus de séduction, ni de danse du reste.

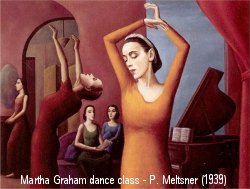 Comme je viens de l’indiquer, Martha Graham est née le 11 mai 1894 à Pittsburgh aux USA. Son père était médecin spécialisé dans les problèmes nerveux. Partant du fait que le corps exprime les maux de l’âme de manière physique, il utilisait l’apparence physique du mouvement comme élément de diagnostic. « La mouvement ne ment pas », disait-il. C’est ce point de vue qui a, plus tard, partiellement inspiré sa fille Martha dans sa manière d’appréhender la danse. La passion pour la danse de celle-ci ne vint qu’en 1911, après avoir vu une représentation du danseur de ballet Ruth Saint-Denis à la Mason Opera House de Los Angeles. La prestation lui plut à tel point qu’elle s’inscrivit quelque temps plus tard à l’école que ce dernier venait de créer avec Ted Shawn, l’école Denishawn. Elle y passa une dizaine d’années, en tant qu’élève au départ, puis en tant qu’enseignante. Elle a toujours considéré que la nouvelle forme de danse qu’elle avait créée était due à ses professeurs Saint-Denis et Shawn.
Comme je viens de l’indiquer, Martha Graham est née le 11 mai 1894 à Pittsburgh aux USA. Son père était médecin spécialisé dans les problèmes nerveux. Partant du fait que le corps exprime les maux de l’âme de manière physique, il utilisait l’apparence physique du mouvement comme élément de diagnostic. « La mouvement ne ment pas », disait-il. C’est ce point de vue qui a, plus tard, partiellement inspiré sa fille Martha dans sa manière d’appréhender la danse. La passion pour la danse de celle-ci ne vint qu’en 1911, après avoir vu une représentation du danseur de ballet Ruth Saint-Denis à la Mason Opera House de Los Angeles. La prestation lui plut à tel point qu’elle s’inscrivit quelque temps plus tard à l’école que ce dernier venait de créer avec Ted Shawn, l’école Denishawn. Elle y passa une dizaine d’années, en tant qu’élève au départ, puis en tant qu’enseignante. Elle a toujours considéré que la nouvelle forme de danse qu’elle avait créée était due à ses professeurs Saint-Denis et Shawn. Plus tard, elle fait ses débuts de danseuse indépendante à New York en 1926, encouragé par le musicien Louis Horst, en se produisant seule sur scène avec sa propre approche de la danse. Celle-ci était basée sur la respiration et l’alternance entre la contraction et le relâchement. On a parfois comparé l’impact de Martha Graham sur la danse à celui de Picasso sur la peinture et sa contribution à l’évolution de la danse moderne est incontestée. Dans sa recherche d’expression personnelle, elle a privilégié la liberté et l’honnêteté, selon ses mots. Elle a créé la Martha Graham Dance Company à New York, l’une des plus anciennes troupes de danse aux États-Unis qui correspond aussi à une école de danse (qui a fêté ses 80 ans cette année). Ses capacités d’enseigner la danse lui ont permis de former et inspirer des générations de danseurs et chorégraphes. La compagnie de Martha Graham commence uniquement avec des femmes. Ce n’est qu’en 1938 qu’un homme viendra les rejoindre (celui-ci, Eric Hawkins, devint d’ailleurs le mari de Martha Graham…). La liste de ses élèves comporte de grands noms comme Merce Cunningham, Alvin Ailey, Twyla Tharp ou Paul Taylor et elle a collaboré avec certains parmi les plus grands artistes de son époque comme le compositeur Aaron Copland et le sculpteur Isamu Noguchi. Même Bette Davis, Gregory Peck, Eli Wallach, Woody Allen ou Madonna suivirent son cours « Movements for Actors ».
Plus tard, elle fait ses débuts de danseuse indépendante à New York en 1926, encouragé par le musicien Louis Horst, en se produisant seule sur scène avec sa propre approche de la danse. Celle-ci était basée sur la respiration et l’alternance entre la contraction et le relâchement. On a parfois comparé l’impact de Martha Graham sur la danse à celui de Picasso sur la peinture et sa contribution à l’évolution de la danse moderne est incontestée. Dans sa recherche d’expression personnelle, elle a privilégié la liberté et l’honnêteté, selon ses mots. Elle a créé la Martha Graham Dance Company à New York, l’une des plus anciennes troupes de danse aux États-Unis qui correspond aussi à une école de danse (qui a fêté ses 80 ans cette année). Ses capacités d’enseigner la danse lui ont permis de former et inspirer des générations de danseurs et chorégraphes. La compagnie de Martha Graham commence uniquement avec des femmes. Ce n’est qu’en 1938 qu’un homme viendra les rejoindre (celui-ci, Eric Hawkins, devint d’ailleurs le mari de Martha Graham…). La liste de ses élèves comporte de grands noms comme Merce Cunningham, Alvin Ailey, Twyla Tharp ou Paul Taylor et elle a collaboré avec certains parmi les plus grands artistes de son époque comme le compositeur Aaron Copland et le sculpteur Isamu Noguchi. Même Bette Davis, Gregory Peck, Eli Wallach, Woody Allen ou Madonna suivirent son cours « Movements for Actors ».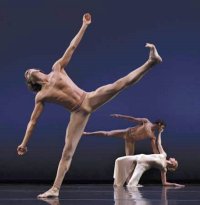 Pour la plupart de ses créations chorégraphiques, Martha Graham créait d’abord la danse avant d’y adjoindre un support musical. Dans de nombreux cas, elle s’occupait aussi elle-même des costumes. Elle a imaginé et chorégraphié plus d’une centaine de ballets dont « Primitive Mysteries » (1931), « Dark Meadow » (1946), « Acrobats of God » (1960), « Lucifer » (1975) pour Noureev et « The Rite of Spring » (1984). On le devine dans ces titres, les chorégraphies de Martha Graham traitent de tous les thèmes humains, de la naissance à la mort en n’évitant pas les thèmes les plus graves. En 1981, sa carrière est couronnée par le premier prix du « American Dance Festival Award » et elle a reçu la « National Medal of Arts » en 1985. Jusque très tard, Martha Graham a accompagné ses danseurs en tournée dans le monde entier, partageant ainsi les ovations du public.
Pour la plupart de ses créations chorégraphiques, Martha Graham créait d’abord la danse avant d’y adjoindre un support musical. Dans de nombreux cas, elle s’occupait aussi elle-même des costumes. Elle a imaginé et chorégraphié plus d’une centaine de ballets dont « Primitive Mysteries » (1931), « Dark Meadow » (1946), « Acrobats of God » (1960), « Lucifer » (1975) pour Noureev et « The Rite of Spring » (1984). On le devine dans ces titres, les chorégraphies de Martha Graham traitent de tous les thèmes humains, de la naissance à la mort en n’évitant pas les thèmes les plus graves. En 1981, sa carrière est couronnée par le premier prix du « American Dance Festival Award » et elle a reçu la « National Medal of Arts » en 1985. Jusque très tard, Martha Graham a accompagné ses danseurs en tournée dans le monde entier, partageant ainsi les ovations du public.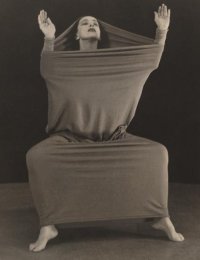 Après sa mort (survenue en 1991), elle est désignée comme la « danseuse du siècle » par Time Magazine (édition du 8 juin 1998) pour l’ensemble de son oeuvre et en particulier sa recherche dans le domaine de l’expression corporelle dans les mouvements et la mise en valeur des angularités du corps. Dans le numéro en question, Time Magazine classe aussi la parmi les 100 personnalités les plus influentes du XXème siècle. Je conclurai cet article par une citation de l’artiste elle-même: « Je voulais commencer non par des personnages ou des idées mais par des mouvements […] Je voulais du mouvement avec du sens. Je ne voulais pas qu’il soit beau ou fluide. Je voulais qu’ils soit lourd de sens intérieur, avec de l’émotion et de brusques montées d’intensité. « . Martha Graham estimait qu’il fallait au moins 10 ans pour devenir une danseuse accomplie.
Après sa mort (survenue en 1991), elle est désignée comme la « danseuse du siècle » par Time Magazine (édition du 8 juin 1998) pour l’ensemble de son oeuvre et en particulier sa recherche dans le domaine de l’expression corporelle dans les mouvements et la mise en valeur des angularités du corps. Dans le numéro en question, Time Magazine classe aussi la parmi les 100 personnalités les plus influentes du XXème siècle. Je conclurai cet article par une citation de l’artiste elle-même: « Je voulais commencer non par des personnages ou des idées mais par des mouvements […] Je voulais du mouvement avec du sens. Je ne voulais pas qu’il soit beau ou fluide. Je voulais qu’ils soit lourd de sens intérieur, avec de l’émotion et de brusques montées d’intensité. « . Martha Graham estimait qu’il fallait au moins 10 ans pour devenir une danseuse accomplie. Je vous propose un exemple de la danse de Martha Graham. Il s’agit de « Lamentation », une célèbre chorégraphie en solo créée en 1930 et dont le costume était représenté tout à fait à droite du Doodle de Google dont je parlais en début d’article. Ce film (ici colorisé) a été tourné par le sculpteur Simon Moselsio en 1943. On y voit Martha Graham s’étirer et tendre son costume tubulaire élastique de couleur prune, un peu comme s’il formait une seconde peau. Elle disait : « J’ai vécu toute ma vie avec la danse. Être danseuse, c’est accepter d’être l’instrument de la vie. C’est parfois déplaisant, mais c’est inévitable« . Bref, on n’aime ou on n’aime pas, mais on n’y reste pas insensible.
Je vous propose un exemple de la danse de Martha Graham. Il s’agit de « Lamentation », une célèbre chorégraphie en solo créée en 1930 et dont le costume était représenté tout à fait à droite du Doodle de Google dont je parlais en début d’article. Ce film (ici colorisé) a été tourné par le sculpteur Simon Moselsio en 1943. On y voit Martha Graham s’étirer et tendre son costume tubulaire élastique de couleur prune, un peu comme s’il formait une seconde peau. Elle disait : « J’ai vécu toute ma vie avec la danse. Être danseuse, c’est accepter d’être l’instrument de la vie. C’est parfois déplaisant, mais c’est inévitable« . Bref, on n’aime ou on n’aime pas, mais on n’y reste pas insensible.
 Mais revenons à nos danses electro… J’ai récemment vu un clip où une manière de danser bien spécifique était mise à l’honneur : le Melbourne shuffle (ou « shuffle » tout court).
Mais revenons à nos danses electro… J’ai récemment vu un clip où une manière de danser bien spécifique était mise à l’honneur : le Melbourne shuffle (ou « shuffle » tout court).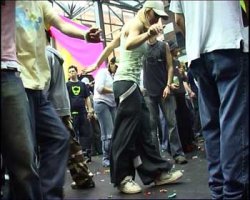 Cela me rappelle exactement la manière dont le lindy hop a trouvé son nom à la fin des années 20… Cela étant, les habitants de Melbourne appelaient cela le « rocking » à l’époque et c’est le public international qui a promu l’appellation « Melbourne shuffle » qui est restée.
Cela me rappelle exactement la manière dont le lindy hop a trouvé son nom à la fin des années 20… Cela étant, les habitants de Melbourne appelaient cela le « rocking » à l’époque et c’est le public international qui a promu l’appellation « Melbourne shuffle » qui est restée.




 D’autres figures existent. Par exemple, le « T-Step » est aussi très utilisé. Il consiste en un déplacement de côté basé sur le fait de poser les pieds l’un dans l’autre en T, ce qui implique un twist au niveau de la cheville. Aux différents pas de base, on peut adjoindre des tours, des twists au niveau des jambes ou des pieds, des glissades, des kicks et quelques mouvements de bras. Certains mouvements, par ailleurs, ont un fort air de ressemblance avec les pas du charleston des années 20 ou le twist des années 60. La similitude avec le charleston est tellement frappante que je ne peux m’empêcher de me demander
D’autres figures existent. Par exemple, le « T-Step » est aussi très utilisé. Il consiste en un déplacement de côté basé sur le fait de poser les pieds l’un dans l’autre en T, ce qui implique un twist au niveau de la cheville. Aux différents pas de base, on peut adjoindre des tours, des twists au niveau des jambes ou des pieds, des glissades, des kicks et quelques mouvements de bras. Certains mouvements, par ailleurs, ont un fort air de ressemblance avec les pas du charleston des années 20 ou le twist des années 60. La similitude avec le charleston est tellement frappante que je ne peux m’empêcher de me demander Dernièrement, deux groupes ont présenté du shuffle dans leurs clips. Il y a tout d’abord les Black Eyed Peas dans « The Time (Dirty Bit) », leur adaptation de « Time of My Life » de la BO de Dirty Dancing. Ils font figurer des danseurs de shuffle dans une boîte de nuit à environ 2’50 du début du clip. À côté de cela, il y a le groupe LMFAO qui a sorti son clip vidéo « Party Rock Anthem » (qui, à l’heure où j’écris ces lignes, passe encore fréquemment sur les chaînes TV musicales) où le shuffle est particulièrement mis à l’honneur aussi bien dans la danse que dans les paroles : « Everyday I’m shufflin' ». La musique est plutôt de la dance electro grand public et n’est pas aussi « hardcore » que les musiques habituellement utilisées pour danser le shuffle, mais tout cela marche très bien ensemble. J’intègre le clip en question dans cet article-ci dessous (vidéo (c) 2011 Interscope) s.
Dernièrement, deux groupes ont présenté du shuffle dans leurs clips. Il y a tout d’abord les Black Eyed Peas dans « The Time (Dirty Bit) », leur adaptation de « Time of My Life » de la BO de Dirty Dancing. Ils font figurer des danseurs de shuffle dans une boîte de nuit à environ 2’50 du début du clip. À côté de cela, il y a le groupe LMFAO qui a sorti son clip vidéo « Party Rock Anthem » (qui, à l’heure où j’écris ces lignes, passe encore fréquemment sur les chaînes TV musicales) où le shuffle est particulièrement mis à l’honneur aussi bien dans la danse que dans les paroles : « Everyday I’m shufflin' ». La musique est plutôt de la dance electro grand public et n’est pas aussi « hardcore » que les musiques habituellement utilisées pour danser le shuffle, mais tout cela marche très bien ensemble. J’intègre le clip en question dans cet article-ci dessous (vidéo (c) 2011 Interscope) s.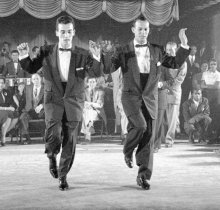 Le shuffle que je viens de vous présenter évidemment n’a rien à voir avec le shuffle des claquettes (une série de deux frappes sur un mouvement aller-retour du pied), mais il y a aussi quelques similitudes sur certains mouvements (on en voit quelques uns dans le clip des Black Eyed Peas que j’ai cité ci-dessus). En effet, certains mouvements de slide (glissade) des claquettes peuvent aussi donner l’impression que donne le « running man » du Melbourne shuffle. Je n’aurais pas été complet si je n’avait cité ce point, ne serait-ce qu’en fin d’article, non ?
Le shuffle que je viens de vous présenter évidemment n’a rien à voir avec le shuffle des claquettes (une série de deux frappes sur un mouvement aller-retour du pied), mais il y a aussi quelques similitudes sur certains mouvements (on en voit quelques uns dans le clip des Black Eyed Peas que j’ai cité ci-dessus). En effet, certains mouvements de slide (glissade) des claquettes peuvent aussi donner l’impression que donne le « running man » du Melbourne shuffle. Je n’aurais pas été complet si je n’avait cité ce point, ne serait-ce qu’en fin d’article, non ?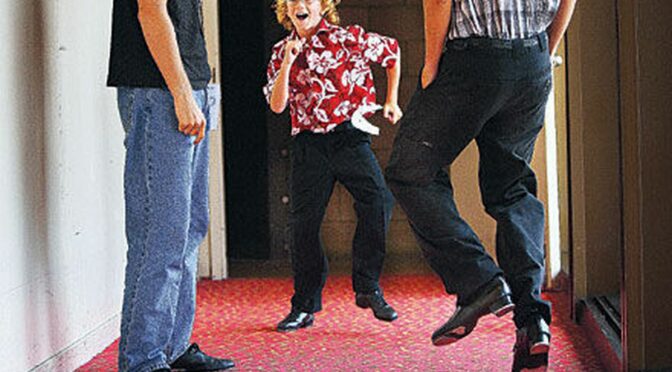
 Si l’on est amateur de danse à claquettes, on reconnaît aisément les claquettes irlandaises (Lord of the Dance, par exemple) et les claquettes américaines qui sont particulièrement identifiables. Les claquettes évoluent et l’on y incorpore aujourd’hui des mouvements et techniques issus d’autres disciplines comme le hip-hop ou les percussions corporelles (body drumming). Mais il existe encore de nos jours une autre manière de faire des claquettes qui existe depuis des lustres et qu’on appelle le clogging. Découvrons donc cela ensemble…
Si l’on est amateur de danse à claquettes, on reconnaît aisément les claquettes irlandaises (Lord of the Dance, par exemple) et les claquettes américaines qui sont particulièrement identifiables. Les claquettes évoluent et l’on y incorpore aujourd’hui des mouvements et techniques issus d’autres disciplines comme le hip-hop ou les percussions corporelles (body drumming). Mais il existe encore de nos jours une autre manière de faire des claquettes qui existe depuis des lustres et qu’on appelle le clogging. Découvrons donc cela ensemble…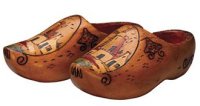 La définition du nom anglais « clog » fait référence à une un poids attaché à la jambe d’un animal pour freiner ses mouvements. Une autre définition fait référence à une chaussure lourde à semelle de bois assimilable à un sabot. Cela revient plus ou moins à la première définition, car il est sûr que des sabots ne permettent pas particulièrement de remporter le 100 mètres haies… Ajoutons que l’une des définitions du verbe « to clog » est le fait de danser le clogging (ou le clog, diront certains). À première vue, le clogging serait donc une manière de danser avec des sabots aux pieds. Mais ne nous arrêtons pas là : on ne porte plus beaucoup de sabots de nos jours.
La définition du nom anglais « clog » fait référence à une un poids attaché à la jambe d’un animal pour freiner ses mouvements. Une autre définition fait référence à une chaussure lourde à semelle de bois assimilable à un sabot. Cela revient plus ou moins à la première définition, car il est sûr que des sabots ne permettent pas particulièrement de remporter le 100 mètres haies… Ajoutons que l’une des définitions du verbe « to clog » est le fait de danser le clogging (ou le clog, diront certains). À première vue, le clogging serait donc une manière de danser avec des sabots aux pieds. Mais ne nous arrêtons pas là : on ne porte plus beaucoup de sabots de nos jours. Le clogging est une forme de danse folklorique américaine originaire de la région des montagnes Appalaches (nord-est des USA) et que l’on appelle aussi « hillbilly tapdancing » ou « flatfooting ». Ces dénominations alternatives donnent bien le ton puisque qu’on y devine une notion « campagnarde » pour la première et l’image de « taper du pied à plat » pour l’autre. En réalité, le clogging des Appalaches est issu d’un mélange de danses apportées par les premiers colons et fut très populaire sur le sol américain dès le 18e siècle. Les Irlandais et les Écossais ont apporté la gigue, les Anglais on apporté leurs jeux de pieds, etc. On dit même que la démarche lourde de certaines danses indiennes avec leurs tambours aurait inspiré le clogging. Dans sa région d’origine, les pas de clogging peuvent varier d’une vallée à l’autre et les danseurs de clogging sont fiers de leurs « spécialités régionales ». Cela dit c’est la standardisation qui a fait que le clogging a pu se propager plus facilement et attirer de nouveaux adeptes au-delà des Appalaches.
Le clogging est une forme de danse folklorique américaine originaire de la région des montagnes Appalaches (nord-est des USA) et que l’on appelle aussi « hillbilly tapdancing » ou « flatfooting ». Ces dénominations alternatives donnent bien le ton puisque qu’on y devine une notion « campagnarde » pour la première et l’image de « taper du pied à plat » pour l’autre. En réalité, le clogging des Appalaches est issu d’un mélange de danses apportées par les premiers colons et fut très populaire sur le sol américain dès le 18e siècle. Les Irlandais et les Écossais ont apporté la gigue, les Anglais on apporté leurs jeux de pieds, etc. On dit même que la démarche lourde de certaines danses indiennes avec leurs tambours aurait inspiré le clogging. Dans sa région d’origine, les pas de clogging peuvent varier d’une vallée à l’autre et les danseurs de clogging sont fiers de leurs « spécialités régionales ». Cela dit c’est la standardisation qui a fait que le clogging a pu se propager plus facilement et attirer de nouveaux adeptes au-delà des Appalaches. Les cloggers portent des vêtements s’approchant plutôt des vêtements portés par les danseurs de square dance, autrement dit une allure plutôt Western (jeans et chemises à carreaux). Côté chaussures, les cloggers portent des chaussures à semelle dure équipées de « steel taps » (de fers) spécifiquement lestées. À la différence des claquettes habituelles, les fers sont composés de deux plaques de métal qui s’entrechoquent à chaque pas et chaque impact avec le sol. Autant dire que ça fait du bruit et que l’image des sabots dont je parlais en début d’article n’est pas loin. Pour un clogger, autrement dit un danseur de clogging, l’essentiel n’est pas de porter des vêtements sophistiqués, ni de faire des pas compliqués. Il faut juste garder le rythme !
Les cloggers portent des vêtements s’approchant plutôt des vêtements portés par les danseurs de square dance, autrement dit une allure plutôt Western (jeans et chemises à carreaux). Côté chaussures, les cloggers portent des chaussures à semelle dure équipées de « steel taps » (de fers) spécifiquement lestées. À la différence des claquettes habituelles, les fers sont composés de deux plaques de métal qui s’entrechoquent à chaque pas et chaque impact avec le sol. Autant dire que ça fait du bruit et que l’image des sabots dont je parlais en début d’article n’est pas loin. Pour un clogger, autrement dit un danseur de clogging, l’essentiel n’est pas de porter des vêtements sophistiqués, ni de faire des pas compliqués. Il faut juste garder le rythme ! De nos jours, on danse le clogging sur à peu près tous les styles musicaux, mais les musiques du top 40 country américain sont souvent utilisées pour créer des enchaînements chorégraphiques. C’est à la base d’enchaînements chorégraphiques que se font les compétitions de clogging qui existent depuis plusieurs années aux USA mettant en vedette de style dit « precision ». Lorsqu’on regarde ces compétitions, on distingue différentes tendances qui vont du folklorique (avec les costumes de style cowboy), au hip-hop (où l’on retrouve des mouvements de bras issus du hip-hop) en passant par le style gymnique (où l’on retrouve des mouvements de bras à la manière du rock sauté). Pour illustrer mon propos, je vous propose une vidéo où les Southern Belles Clogging se produisent en compétition en 2007.
De nos jours, on danse le clogging sur à peu près tous les styles musicaux, mais les musiques du top 40 country américain sont souvent utilisées pour créer des enchaînements chorégraphiques. C’est à la base d’enchaînements chorégraphiques que se font les compétitions de clogging qui existent depuis plusieurs années aux USA mettant en vedette de style dit « precision ». Lorsqu’on regarde ces compétitions, on distingue différentes tendances qui vont du folklorique (avec les costumes de style cowboy), au hip-hop (où l’on retrouve des mouvements de bras issus du hip-hop) en passant par le style gymnique (où l’on retrouve des mouvements de bras à la manière du rock sauté). Pour illustrer mon propos, je vous propose une vidéo où les Southern Belles Clogging se produisent en compétition en 2007.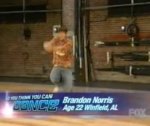 Je n’ai pas connaissance d’une quelconque pratique du clogging en France où les claquettes américaines et irlandaises sont bien développées. J’ai découvert cette manière de danser dans l’émission américaine « So You Think You Can Dance » que j’ai déjà plusieurs fois évoquée ici. En tout état de cause, comme les claquettes que nous pratiquons de nos jours prennent partiellement leurs origines dans le clogging américain, il me semble intéressant de connaître quelques éléments sur cette discipline. S’il y a d’autres disciplines que vous aimeriez découvrir dans ce blog, glissez-moi donc un petit mot et je programmerai un article sur le sujet (non sans m’être sérieusement documenté sur le sujet au préalable comme d’habitude !).
Je n’ai pas connaissance d’une quelconque pratique du clogging en France où les claquettes américaines et irlandaises sont bien développées. J’ai découvert cette manière de danser dans l’émission américaine « So You Think You Can Dance » que j’ai déjà plusieurs fois évoquée ici. En tout état de cause, comme les claquettes que nous pratiquons de nos jours prennent partiellement leurs origines dans le clogging américain, il me semble intéressant de connaître quelques éléments sur cette discipline. S’il y a d’autres disciplines que vous aimeriez découvrir dans ce blog, glissez-moi donc un petit mot et je programmerai un article sur le sujet (non sans m’être sérieusement documenté sur le sujet au préalable comme d’habitude !).
 La danse est généralement vécue par ses pratiquants comme un vrai plaisir. Mais le plaisir vient aussi probablement de la synergie qui doit exister entre la musique et la danse. J’ai déjà eu l’occasion de critiquer dans ce blog l’inadéquation entre une musique que l’on entend et la danse que l’on effectue dessus. Ce genre de situation arrive particulièrement dans les soirées de danse « en société ». Pour ce qui concerne l’animation musicale, les fameuses soirées dansantes sont de deux types. Il y a tout d’abord les soirées CD et il y a aussi les soirées avec un orchestre en direct live. Aujourd’hui, je vous parle donc musique à danser et des musiciens qui vont avec.
La danse est généralement vécue par ses pratiquants comme un vrai plaisir. Mais le plaisir vient aussi probablement de la synergie qui doit exister entre la musique et la danse. J’ai déjà eu l’occasion de critiquer dans ce blog l’inadéquation entre une musique que l’on entend et la danse que l’on effectue dessus. Ce genre de situation arrive particulièrement dans les soirées de danse « en société ». Pour ce qui concerne l’animation musicale, les fameuses soirées dansantes sont de deux types. Il y a tout d’abord les soirées CD et il y a aussi les soirées avec un orchestre en direct live. Aujourd’hui, je vous parle donc musique à danser et des musiciens qui vont avec. Dans le premier type de soirées dansantes que je viens d’énoncer, l’animation musicale est faite en utilisant de la musique enregistrée (CD, MP3, etc.). La programmation musicale est en général faite par une personne (un DJ, tout comme dans n’importe quelle boîte de nuit). Cependant, ce DJ est un peu spécial dans le cadre des soirées de danses en couple, danses de salon, danses sociales, danses swing, danses latino, etc. Ce DJ en effet ne parle pas BPM (battements par minute) comme en boîte de nuit classique, il parle MPM (mesures par minute) pour déterminer le tempo d’un morceau. Cela signifie que, comme un enseignant qui contrôle la progression et les aptitudes de ses élèves, le DJ doit pouvoir contrôler le déroulement de sa soirée en termes de difficulté, d’ambiance et de variété. Côté difficulté, c’est effectivement le facteur MPM qui peut déterminer cela : plus la musique est rapide et moins elle est accessible aux débutants. L’ambiance est déterminée partiellement par le plaisir que prend le public : il faut donc passer des morceaux spécifiquement adaptés à la danse et ne pas satisfaire tout le temps les débutants au détriment des avancés ou inversement. Enfin, il semble logique qu’une soirée « toutes danses » doive proposer une variété de rythmes (rock, cha-cha, valse, tango, etc.) et répondre aux attentes des danseurs présents. Le DJ s’adapte donc généralement au public qu’il a en face : une soirée d’association rurale n’est probablement pas la même qu’une soirée d’école de danse citadine qui fait de la compétition de danse sportive ou qui est spécialisée en swing.
Dans le premier type de soirées dansantes que je viens d’énoncer, l’animation musicale est faite en utilisant de la musique enregistrée (CD, MP3, etc.). La programmation musicale est en général faite par une personne (un DJ, tout comme dans n’importe quelle boîte de nuit). Cependant, ce DJ est un peu spécial dans le cadre des soirées de danses en couple, danses de salon, danses sociales, danses swing, danses latino, etc. Ce DJ en effet ne parle pas BPM (battements par minute) comme en boîte de nuit classique, il parle MPM (mesures par minute) pour déterminer le tempo d’un morceau. Cela signifie que, comme un enseignant qui contrôle la progression et les aptitudes de ses élèves, le DJ doit pouvoir contrôler le déroulement de sa soirée en termes de difficulté, d’ambiance et de variété. Côté difficulté, c’est effectivement le facteur MPM qui peut déterminer cela : plus la musique est rapide et moins elle est accessible aux débutants. L’ambiance est déterminée partiellement par le plaisir que prend le public : il faut donc passer des morceaux spécifiquement adaptés à la danse et ne pas satisfaire tout le temps les débutants au détriment des avancés ou inversement. Enfin, il semble logique qu’une soirée « toutes danses » doive proposer une variété de rythmes (rock, cha-cha, valse, tango, etc.) et répondre aux attentes des danseurs présents. Le DJ s’adapte donc généralement au public qu’il a en face : une soirée d’association rurale n’est probablement pas la même qu’une soirée d’école de danse citadine qui fait de la compétition de danse sportive ou qui est spécialisée en swing. Tous ces paramètres sont généralement ajustés en temps réel tout au long de la soirée par un DJ (ou disc-jockey). Un bon DJ est un DJ qui est en permanence à l’écoute des danseurs, qui sait juger s’ils sont fatigués où à quel moment ils souhaitent se défouler et qui sait donc adapter en permanence sa programmation aux conditions de la soirée. Depuis quelques années, cependant, un facteur perturbant est venu s’insérer dans ce type de soirées dansantes : l’ordinateur. C’est l’avènement du format musical MP3 et de la virtualisation des platines de DJ qui a permis de mettre l’ordinateur (généralement portable) au centre de la diffusion de musique lors des soirées dansantes. Le logiciel de DJing, parfois assorti d’un périphérique dédié simulant les platines CD manuelles, permet de visualiser à l’écran sa collection de musique MP3, de l’organiser, d’y faire sa sélection et de paramétrer l’ordre de passage pour le déroulement automatique d’une soirée dansante. Ainsi, plus la peine d’avoir quelqu’un devant le clavier et l’écran : le DJ peut très bien aller s’amuser et danser avec les autres participants. Pratique lorsque tout se déroule bien et lorsqu’on n’a cure de répondre aux attentes mouvantes des danseurs sur la piste. J’ai déjà vu plusieurs fois des soirées de ce type où le programme se déroulait coûte que coûte à l’aveugle jusqu’au point où il n’y avait plus aucun danseur sur la piste pendant plusieurs minutes faute de musique répondant aux attentes. Ce n’est pas l’image d’une soirée réussie qui est restée dans la mémoire des participants à ce genre de soirée…
Tous ces paramètres sont généralement ajustés en temps réel tout au long de la soirée par un DJ (ou disc-jockey). Un bon DJ est un DJ qui est en permanence à l’écoute des danseurs, qui sait juger s’ils sont fatigués où à quel moment ils souhaitent se défouler et qui sait donc adapter en permanence sa programmation aux conditions de la soirée. Depuis quelques années, cependant, un facteur perturbant est venu s’insérer dans ce type de soirées dansantes : l’ordinateur. C’est l’avènement du format musical MP3 et de la virtualisation des platines de DJ qui a permis de mettre l’ordinateur (généralement portable) au centre de la diffusion de musique lors des soirées dansantes. Le logiciel de DJing, parfois assorti d’un périphérique dédié simulant les platines CD manuelles, permet de visualiser à l’écran sa collection de musique MP3, de l’organiser, d’y faire sa sélection et de paramétrer l’ordre de passage pour le déroulement automatique d’une soirée dansante. Ainsi, plus la peine d’avoir quelqu’un devant le clavier et l’écran : le DJ peut très bien aller s’amuser et danser avec les autres participants. Pratique lorsque tout se déroule bien et lorsqu’on n’a cure de répondre aux attentes mouvantes des danseurs sur la piste. J’ai déjà vu plusieurs fois des soirées de ce type où le programme se déroulait coûte que coûte à l’aveugle jusqu’au point où il n’y avait plus aucun danseur sur la piste pendant plusieurs minutes faute de musique répondant aux attentes. Ce n’est pas l’image d’une soirée réussie qui est restée dans la mémoire des participants à ce genre de soirée… À l’opposé du « tout automatique et tout enregistré », il y a le « tout en direct et avec orchestre ». Là ça peut être le pied. Dans le cas idéal, les musiciens sont en forme, ils ont un vaste répertoire dansant et des orchestrations qui donnent envie aux danseurs de se remuer. Si l’on ajoute à cela, une bonne sonorisation, des pauses adéquates et des danseuses et danseurs qui respectent les musiciens, on obtient une soirée mémorable pour tout le monde. Imaginez qu’au lieu de simplement installer un ampli, des enceintes, un ordinateur et trois spots automatiques, il a fallu redoubler d’efforts pour préparer le terrain : accueil des musiciens (vestiaires, salle de repos), organisation de l’espace réservé à l’orchestre (montage de la scène), mise en place de la sono, des instruments (batterie, piano, etc. parfois) et des microphones, petite répétition avec les instruments et réglages de la sonorisation (balance) pour que l’intervention des instruments soit globalement équilibrée, réglage de la lumière, organisation du ravitaillement des musiciens (boissons, repas), etc.
À l’opposé du « tout automatique et tout enregistré », il y a le « tout en direct et avec orchestre ». Là ça peut être le pied. Dans le cas idéal, les musiciens sont en forme, ils ont un vaste répertoire dansant et des orchestrations qui donnent envie aux danseurs de se remuer. Si l’on ajoute à cela, une bonne sonorisation, des pauses adéquates et des danseuses et danseurs qui respectent les musiciens, on obtient une soirée mémorable pour tout le monde. Imaginez qu’au lieu de simplement installer un ampli, des enceintes, un ordinateur et trois spots automatiques, il a fallu redoubler d’efforts pour préparer le terrain : accueil des musiciens (vestiaires, salle de repos), organisation de l’espace réservé à l’orchestre (montage de la scène), mise en place de la sono, des instruments (batterie, piano, etc. parfois) et des microphones, petite répétition avec les instruments et réglages de la sonorisation (balance) pour que l’intervention des instruments soit globalement équilibrée, réglage de la lumière, organisation du ravitaillement des musiciens (boissons, repas), etc.  Et tout cela n’est que la préparation ! Pensez bien qu’une fois la soirée finie, il faut encore ranger tout cela, démonter la scène, payer les musiciens, etc. C’est plus compliqué, mais c’est comme cela qu’un orchestre aura envie de s’investir et qu’il pourra faire danser l’assistance jusqu’au bout de la nuit… Lors d’une soirée avec orchestre, les musiciens proposent la musique aux danseurs, qui en disposent. Les musiciens gèrent, morceau après morceau, l’ambiance de la soirée en fonction de ce qu’ils voient sur la piste de danse (il est donc important que les danseurs ne soient pas dans l’obscurité, ni les musiciens aveuglés par les spots lumineux). À l’inverse, les danseurs dansent en fonction de ce qu’ils entendent, interprètent la musique et peuvent réagit à la moindre surprise. Et des surprises, certains musiciens et chanteurs habitués aux soirées dansantes en parsèment leurs prestations à la plus grande joie des danseurs. Je me souviens d’une soirée swing où, dans la prolongation d’un couplet lent, la chanteuse (Jennie Löbel pour ne pas la citer) s’est envolée dans un scat de plus en plus rapide annonçant habituellement une section rapide pour, au bout de sa course de « bidouap tibidibidi », nonchalamment continuer sa chanson à la vitesse lente initiale, alors que les danseurs s’apprêtaient à dynamiser leur danse. Elle s’est amusée de ce contre-pied avec un petit sourire tandis qu’une grande partie des danseurs de la salle éclataient de rire.
Et tout cela n’est que la préparation ! Pensez bien qu’une fois la soirée finie, il faut encore ranger tout cela, démonter la scène, payer les musiciens, etc. C’est plus compliqué, mais c’est comme cela qu’un orchestre aura envie de s’investir et qu’il pourra faire danser l’assistance jusqu’au bout de la nuit… Lors d’une soirée avec orchestre, les musiciens proposent la musique aux danseurs, qui en disposent. Les musiciens gèrent, morceau après morceau, l’ambiance de la soirée en fonction de ce qu’ils voient sur la piste de danse (il est donc important que les danseurs ne soient pas dans l’obscurité, ni les musiciens aveuglés par les spots lumineux). À l’inverse, les danseurs dansent en fonction de ce qu’ils entendent, interprètent la musique et peuvent réagit à la moindre surprise. Et des surprises, certains musiciens et chanteurs habitués aux soirées dansantes en parsèment leurs prestations à la plus grande joie des danseurs. Je me souviens d’une soirée swing où, dans la prolongation d’un couplet lent, la chanteuse (Jennie Löbel pour ne pas la citer) s’est envolée dans un scat de plus en plus rapide annonçant habituellement une section rapide pour, au bout de sa course de « bidouap tibidibidi », nonchalamment continuer sa chanson à la vitesse lente initiale, alors que les danseurs s’apprêtaient à dynamiser leur danse. Elle s’est amusée de ce contre-pied avec un petit sourire tandis qu’une grande partie des danseurs de la salle éclataient de rire. Ce fut une fois où nous dansâmes vraiment sur la musique et c’était comme si l’orchestre captait tout ce que nous faisions. À chaque fois que je lançai fort ma jambe, Chick disait : » chiboum ! » Si je faisais un petit swing out, Taft Jordan jouait : » biiyooouuww ! » Frieda avait l’un des twists les plus géniaux de toutes les filles et elle savait vraiment le mettre en valeur. Quand elle faisait des twists autour de moi, Chick Webb jouait : » chiii-chichi, chiii-chi-chi » sur les cymbales, tenant la mesure avec elle. Ils jouaient un riff derrière moi et je pensais : » Ouais, restez avec moi les gars ! » Je ressentais tout ce qu’ils faisaient et l’orchestre marquait chaque pas que nous faisions.
Ce fut une fois où nous dansâmes vraiment sur la musique et c’était comme si l’orchestre captait tout ce que nous faisions. À chaque fois que je lançai fort ma jambe, Chick disait : » chiboum ! » Si je faisais un petit swing out, Taft Jordan jouait : » biiyooouuww ! » Frieda avait l’un des twists les plus géniaux de toutes les filles et elle savait vraiment le mettre en valeur. Quand elle faisait des twists autour de moi, Chick Webb jouait : » chiii-chichi, chiii-chi-chi » sur les cymbales, tenant la mesure avec elle. Ils jouaient un riff derrière moi et je pensais : » Ouais, restez avec moi les gars ! » Je ressentais tout ce qu’ils faisaient et l’orchestre marquait chaque pas que nous faisions.
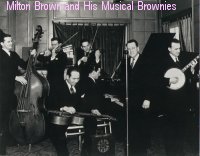 Dans un autre genre, l’interaction entre les danseurs et les musiciens est un peu différente, mais elle est tout aussi présente. Dans le livre « La danse country & western » de Ralph G. Giordano (à sortir en français avant l’été : je suis en train de travailler sur sa traduction), l’auteur décrit, entre autres thèmes, l’ambiance des honky-tonks et des salles de danse au Texas. Il raconte quelque chose qui montre bien que les danseurs peuvent être attachés à un orchestre et au fait qu’il y ait de la musique dans une soirée…
Dans un autre genre, l’interaction entre les danseurs et les musiciens est un peu différente, mais elle est tout aussi présente. Dans le livre « La danse country & western » de Ralph G. Giordano (à sortir en français avant l’été : je suis en train de travailler sur sa traduction), l’auteur décrit, entre autres thèmes, l’ambiance des honky-tonks et des salles de danse au Texas. Il raconte quelque chose qui montre bien que les danseurs peuvent être attachés à un orchestre et au fait qu’il y ait de la musique dans une soirée… Dans certaines soirées dansantes, je suis peiné de voir que les danseurs ne « calculent » pas les musiciens qui jouent pour eux. Ils dansent exactement comme s’ils entendaient le son d’un CD sortir des haut-parleurs, ignorant sereinement qu’il y a quelques bonshommes qui gigotent sur l’estrade d’où vient le son. Imaginez une soirée dansante où l’ensemble des danseurs ignore les musiciens. Cela ne donne assurément pas à ces derniers l’envie de se démener pour faire la meilleure prestation possible et cela devient aussi assez désagréable pour eux. Les musiciens aiment savoir qu’ils jouent pour un public et s’ils voient que, en plus, le public s’amuse en dansant et apprécie ce qui est joué, cela les motive d’autant plus. C’est là que les petites surprises musicales peuvent survenir. Ainsi, lorsque vous dansez sur la musique d’un orchestre en direct, jetez de temps en temps un coup d’oeil aux musiciens avec un grand sourire, réagissez aux subtilités de ce qu’ils jouent et applaudissez pour les remercier lorsque le morceau est fini. Dans certaines soirées swing, il est courant que les danseurs insèrent un shim-sham pour remercier l’orchestre. Le principe est simple : tous les danseurs se mettent face à l’orchestre et dansent à l’unisson la chorégraphie de danse swing en ligne du shim-sham. Il existe plusieurs variantes de shim-sham et le shim-sham promu, entre autres, par Frankie Manning est entièrement détaillé dans mon livre « Le lindy hop et le balboa », sorti en 2010.
Dans certaines soirées dansantes, je suis peiné de voir que les danseurs ne « calculent » pas les musiciens qui jouent pour eux. Ils dansent exactement comme s’ils entendaient le son d’un CD sortir des haut-parleurs, ignorant sereinement qu’il y a quelques bonshommes qui gigotent sur l’estrade d’où vient le son. Imaginez une soirée dansante où l’ensemble des danseurs ignore les musiciens. Cela ne donne assurément pas à ces derniers l’envie de se démener pour faire la meilleure prestation possible et cela devient aussi assez désagréable pour eux. Les musiciens aiment savoir qu’ils jouent pour un public et s’ils voient que, en plus, le public s’amuse en dansant et apprécie ce qui est joué, cela les motive d’autant plus. C’est là que les petites surprises musicales peuvent survenir. Ainsi, lorsque vous dansez sur la musique d’un orchestre en direct, jetez de temps en temps un coup d’oeil aux musiciens avec un grand sourire, réagissez aux subtilités de ce qu’ils jouent et applaudissez pour les remercier lorsque le morceau est fini. Dans certaines soirées swing, il est courant que les danseurs insèrent un shim-sham pour remercier l’orchestre. Le principe est simple : tous les danseurs se mettent face à l’orchestre et dansent à l’unisson la chorégraphie de danse swing en ligne du shim-sham. Il existe plusieurs variantes de shim-sham et le shim-sham promu, entre autres, par Frankie Manning est entièrement détaillé dans mon livre « Le lindy hop et le balboa », sorti en 2010. Sans la musique et les musiciens qui la composent et la jouent, il n’y aurait pas de soirées dansantes, ni de cours de danse. Ce qui me désole parfois, c’est de voir des danseuses et danseurs considérer la musique comme un simple accessoire. Certains demandent : « passe-moi une valse, n’importe laquelle, je m’en fiche », d’autres disent : « cette chanson est nulle » alors que d’autres adorent danser dessus. Il y a aussi des personnes qui copient des CD sans se préoccuper de savoir ce qu’il y avait d’écrit sur la pochette, ni quel artiste en interprète la musique. Je pense que ce qu’il y a de pire que de copier illégalement un CD, c’est de ne pas respecter l’artiste qui l’a créé. Quand on aime un morceau de musique, la moindre des choses est de s’intéresser à l’artiste qui en est l’auteur. Bien sûr, on ne mémorise pas tout d’un seul coup et c’est à force d’écouter et de lire le nom de l’artiste associé à une chanson qu’on le mémorise. Dans le même esprit, si vous adorez un artiste et que vous écoutez souvent ses chansons issues d’un CD ou d’un MP3 piraté (il faut tout de même prendre la réalité en compte), la moindre des choses est, au moins de temps en temps, d’acheter légalement un CD ou un MP3 de cet artiste. Il faut garder en mémoire que sa musique c’est son gagne-pain. C’est d’autant plus vrai pour les « petits » artistes et les « petits » labels qui fonctionnent d’une manière proche de l’artisanat. C’est à la fois une question de reconnaissance et une question de respect pour l’artiste.
Sans la musique et les musiciens qui la composent et la jouent, il n’y aurait pas de soirées dansantes, ni de cours de danse. Ce qui me désole parfois, c’est de voir des danseuses et danseurs considérer la musique comme un simple accessoire. Certains demandent : « passe-moi une valse, n’importe laquelle, je m’en fiche », d’autres disent : « cette chanson est nulle » alors que d’autres adorent danser dessus. Il y a aussi des personnes qui copient des CD sans se préoccuper de savoir ce qu’il y avait d’écrit sur la pochette, ni quel artiste en interprète la musique. Je pense que ce qu’il y a de pire que de copier illégalement un CD, c’est de ne pas respecter l’artiste qui l’a créé. Quand on aime un morceau de musique, la moindre des choses est de s’intéresser à l’artiste qui en est l’auteur. Bien sûr, on ne mémorise pas tout d’un seul coup et c’est à force d’écouter et de lire le nom de l’artiste associé à une chanson qu’on le mémorise. Dans le même esprit, si vous adorez un artiste et que vous écoutez souvent ses chansons issues d’un CD ou d’un MP3 piraté (il faut tout de même prendre la réalité en compte), la moindre des choses est, au moins de temps en temps, d’acheter légalement un CD ou un MP3 de cet artiste. Il faut garder en mémoire que sa musique c’est son gagne-pain. C’est d’autant plus vrai pour les « petits » artistes et les « petits » labels qui fonctionnent d’une manière proche de l’artisanat. C’est à la fois une question de reconnaissance et une question de respect pour l’artiste.
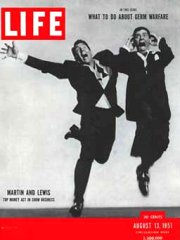 Dans les années 1945 à 1956, un duo d’artistes était particulièrement connu aux États-Unis aussi bien pour la qualité de ses sketches qui contenaient aussi bien des chansons que de la danse. Ce duo, mêlant le charme de crooner de l’un de ses membres à l’humour déjanté du second était composé de Dean Martin et de Jerry Lewis. Ce sont deux personnages que l’on a un peu oubliés (et en particulier leur duo à succès) et que je vous propose de redécouvrir ci-après, avec un focus sur leurs prestations dansées qui tenaient une place particulièrement importante dans leurs numéros.
Dans les années 1945 à 1956, un duo d’artistes était particulièrement connu aux États-Unis aussi bien pour la qualité de ses sketches qui contenaient aussi bien des chansons que de la danse. Ce duo, mêlant le charme de crooner de l’un de ses membres à l’humour déjanté du second était composé de Dean Martin et de Jerry Lewis. Ce sont deux personnages que l’on a un peu oubliés (et en particulier leur duo à succès) et que je vous propose de redécouvrir ci-après, avec un focus sur leurs prestations dansées qui tenaient une place particulièrement importante dans leurs numéros. Durant toutes ces années de collaboration, les deux artistes ont persemé leurs numéros de danse. Essentiellement de la danse en couple, mais pas seulement. Cela est arrivé dans des émissions de télévision, mais aussi dans des films. Par exemple, dans le film « Livig It Up » de 1954 (photo ci-contre), on voit Jerry Lewis danser le lindy hop/jitterbug avec Sheree North. Même s’il fait le pitre, on devine bien ses qualités de danseur (que je vous propose de découvrir à la fin de cet article). Pour le duo de choc, l’émission « Colgate Comedy Hour » (voir plus bas) a été un terrain expérimental particulièrement riche où ils s’adonnaient à toutes sortes d’exercices allant du sketch burlesque à des prestations aux allures de comédie musicale. Et il faut bien avouer qu’ils n’hésitaient pas à faire quelques pas dans les bras l’un de l’autre pour faire rire le public. C’est dans cet état d’esprit caractéristique que ces amoureux du jazz et des danses associées ont fait découvrir le swing à des milliers d’Américains.
Durant toutes ces années de collaboration, les deux artistes ont persemé leurs numéros de danse. Essentiellement de la danse en couple, mais pas seulement. Cela est arrivé dans des émissions de télévision, mais aussi dans des films. Par exemple, dans le film « Livig It Up » de 1954 (photo ci-contre), on voit Jerry Lewis danser le lindy hop/jitterbug avec Sheree North. Même s’il fait le pitre, on devine bien ses qualités de danseur (que je vous propose de découvrir à la fin de cet article). Pour le duo de choc, l’émission « Colgate Comedy Hour » (voir plus bas) a été un terrain expérimental particulièrement riche où ils s’adonnaient à toutes sortes d’exercices allant du sketch burlesque à des prestations aux allures de comédie musicale. Et il faut bien avouer qu’ils n’hésitaient pas à faire quelques pas dans les bras l’un de l’autre pour faire rire le public. C’est dans cet état d’esprit caractéristique que ces amoureux du jazz et des danses associées ont fait découvrir le swing à des milliers d’Américains. Pendant longtemps, j’ai cru que Dean Martin était simplement un chanteur grâce à des CD de compilation de crooners et Jerry Lewis un clown à cause de la rediffusion de certains films comme « Docteur Jerry et Mister Love ». Ce n’est que plus tard, avec l’ère de Youtube, que je suis tombé sur des vidéos d’époque qui m’ont prouvé qu’ils aimaient aussi beaucoup la danse et qu’ils en parsemaient leurs numéros pour notre plus grand plaisir. J’ai souhaité limiter à 3 le nombre de vidéos de cet article, mais je vous conseille d’aller faire un tour sur les sites d’hébergement de vidéos (Youtube ou Dailymotion) et d’en découvrir d’autres (dont certaines faites chacun de son côté après la fin de leur duo).
Pendant longtemps, j’ai cru que Dean Martin était simplement un chanteur grâce à des CD de compilation de crooners et Jerry Lewis un clown à cause de la rediffusion de certains films comme « Docteur Jerry et Mister Love ». Ce n’est que plus tard, avec l’ère de Youtube, que je suis tombé sur des vidéos d’époque qui m’ont prouvé qu’ils aimaient aussi beaucoup la danse et qu’ils en parsemaient leurs numéros pour notre plus grand plaisir. J’ai souhaité limiter à 3 le nombre de vidéos de cet article, mais je vous conseille d’aller faire un tour sur les sites d’hébergement de vidéos (Youtube ou Dailymotion) et d’en découvrir d’autres (dont certaines faites chacun de son côté après la fin de leur duo).
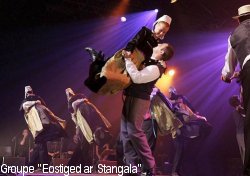 S’il est intéressant de découvrir les danses traditionnelles de France dans leur ensemble, il est encore plus intéressant d’approfondir le cas de certaines d’entre elles. Mon nom de famille ne cache pas mes origines bretonnes et il me semble donc logique de vous présenter un peu de la culture qui est la mienne. Ce n’est pas parce que j’ai émigré vers le Sud que j’en oublie mes racines, loin de là. Je vous invite donc à passer quelques minutes dans le monde des danses bretonnes (comme la célèbre gavotte) où le fest noz et la langue bretonne sont bien présents. Précisons dès à présent que danse se dit dañs en breton et que cela se prononce comme le mot français.
S’il est intéressant de découvrir les danses traditionnelles de France dans leur ensemble, il est encore plus intéressant d’approfondir le cas de certaines d’entre elles. Mon nom de famille ne cache pas mes origines bretonnes et il me semble donc logique de vous présenter un peu de la culture qui est la mienne. Ce n’est pas parce que j’ai émigré vers le Sud que j’en oublie mes racines, loin de là. Je vous invite donc à passer quelques minutes dans le monde des danses bretonnes (comme la célèbre gavotte) où le fest noz et la langue bretonne sont bien présents. Précisons dès à présent que danse se dit dañs en breton et que cela se prononce comme le mot français.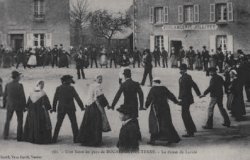 La première danse bretonne dépeinte par écrit serait le trihori. (On rapproche le nom de trihori du breton tri c’hoari qui signifie « trois jeux » en référence aux trois parties composant la danse.) On retrouve sa trace dans un document de 1588 de Thoinot Arbeau qui la décrit comme une sorte de branle (danse du moyen-âge). En cette comparaison, on trouve donc des similitudes avec des danses traditionnelles d’autres régions de France. En Basse-Bretagne, on distingue cinq danses dont semblent découler les autres : la gavotte (dañs tro, largement diffusée), l’an dro parfois écrit en dro (région de Vannes et souvent associé à l’hanter dro), la dañs Treger (région du Trégor), la dañs Leon (Nord du Finistère) et la dañs tro plinn (centre de la Basse-Bretagne). En Haute-Bretagne, c’est moins clair, car les travaux de recensement n’ont été réalisés que tardivement. On trouve néanmoins clairement des danses apparentées à l’an dro bas-breton, des ronds ou rondes, des passe-pieds, des branles vendéens. On remarque l’absence de noms bretons pour ces danses de Haute-Bretagne. Toutes ces danses se pratiquaient souvent en cercles fermés. On peut ainsi citer d’autres danses connues comme la ridée, le laridé, la danse du loup, le jabadao, la dañs plinn, mais aussi en Haute-Bretagne la pastourelle, l’avant-deux et les quadrilles.
La première danse bretonne dépeinte par écrit serait le trihori. (On rapproche le nom de trihori du breton tri c’hoari qui signifie « trois jeux » en référence aux trois parties composant la danse.) On retrouve sa trace dans un document de 1588 de Thoinot Arbeau qui la décrit comme une sorte de branle (danse du moyen-âge). En cette comparaison, on trouve donc des similitudes avec des danses traditionnelles d’autres régions de France. En Basse-Bretagne, on distingue cinq danses dont semblent découler les autres : la gavotte (dañs tro, largement diffusée), l’an dro parfois écrit en dro (région de Vannes et souvent associé à l’hanter dro), la dañs Treger (région du Trégor), la dañs Leon (Nord du Finistère) et la dañs tro plinn (centre de la Basse-Bretagne). En Haute-Bretagne, c’est moins clair, car les travaux de recensement n’ont été réalisés que tardivement. On trouve néanmoins clairement des danses apparentées à l’an dro bas-breton, des ronds ou rondes, des passe-pieds, des branles vendéens. On remarque l’absence de noms bretons pour ces danses de Haute-Bretagne. Toutes ces danses se pratiquaient souvent en cercles fermés. On peut ainsi citer d’autres danses connues comme la ridée, le laridé, la danse du loup, le jabadao, la dañs plinn, mais aussi en Haute-Bretagne la pastourelle, l’avant-deux et les quadrilles. Comme pour beaucoup de danses traditionnelles, la pratique a longtemps été essentiellement tournée vers les moments clef de la vie des gens : grands travaux agricoles (moissons, arrachage des pommes de terre, grands défrichages, etc.), activités de groupe (confection de paniers, etc.), événements familiaux (mariage, etc.), événements commerciaux (foires), événements religieux (pardons, feux de la Saint-Jean, etc.) La danse était accompagnée de chants ou de musiciens (sonneurs de biniou et de bombarde, mais ils ont été rejoints par des joueurs de violon, de clarinette ou d’accordéon). Le recours aux musiciens (qui étaient payés) avait généralement lieu lors de grands événements. Les autres fois, les danses étaient animées par des chanteurs (qui n’étaient pas payés, eux) qui peuvent très bien danser en même temps qu’ils chantent. À noter, la spécificité des chants bretons en la technique du kan ha diskan (« chant et contre-chant ») où deux chanteurs alternent en une sorte de question-réponse.
Comme pour beaucoup de danses traditionnelles, la pratique a longtemps été essentiellement tournée vers les moments clef de la vie des gens : grands travaux agricoles (moissons, arrachage des pommes de terre, grands défrichages, etc.), activités de groupe (confection de paniers, etc.), événements familiaux (mariage, etc.), événements commerciaux (foires), événements religieux (pardons, feux de la Saint-Jean, etc.) La danse était accompagnée de chants ou de musiciens (sonneurs de biniou et de bombarde, mais ils ont été rejoints par des joueurs de violon, de clarinette ou d’accordéon). Le recours aux musiciens (qui étaient payés) avait généralement lieu lors de grands événements. Les autres fois, les danses étaient animées par des chanteurs (qui n’étaient pas payés, eux) qui peuvent très bien danser en même temps qu’ils chantent. À noter, la spécificité des chants bretons en la technique du kan ha diskan (« chant et contre-chant ») où deux chanteurs alternent en une sorte de question-réponse. La danse bretonne la plus connue de nom est probablement la gavotte. Cette danse bretonne (aussi appelée dañs tro en breton) doit son appellation française à la gavotte française dansée à la Cour du fait que les deux danses se pratiquent en cercle, mais il semble que l’origine de la danse n’ait pas de rapport avec la gavotte française. Les pas de la gavotte bretonne varient selon la zone géographique où elle est pratiquée (différence au niveau des changements d’appuis, petits sauts, vitesse, etc.). Cette zone s’étend sur environ les 3/4 de la Basse-Bretagne. La gavotte peut se trouver au sein de suites de danses incluant des moments de repos (parfois marqués par une marche). Je réserve une description détaillée des pas pour un autre article.
La danse bretonne la plus connue de nom est probablement la gavotte. Cette danse bretonne (aussi appelée dañs tro en breton) doit son appellation française à la gavotte française dansée à la Cour du fait que les deux danses se pratiquent en cercle, mais il semble que l’origine de la danse n’ait pas de rapport avec la gavotte française. Les pas de la gavotte bretonne varient selon la zone géographique où elle est pratiquée (différence au niveau des changements d’appuis, petits sauts, vitesse, etc.). Cette zone s’étend sur environ les 3/4 de la Basse-Bretagne. La gavotte peut se trouver au sein de suites de danses incluant des moments de repos (parfois marqués par une marche). Je réserve une description détaillée des pas pour un autre article. Même si elle est la plus connue du fait de son nom français, ce n’est pas à la gavotte à laquelle pensent les touristes se rendant en Bretagne. Ils ont en tête l’image d’une danse se dansant en cercle, certes, mais qui comporte des mouvements de bras et où les danseurs se tiennent par le petit doigt. En réalité, il s’agit là de l’an dro (que l’on peut traduire par « la ronde » ou « le tour » en français). Cette danse peut aussi se faire en chaîne ouverte où les hommes et les femmes sont alternés et se tiennent effectivement par le petit doigt. Le néophyte en danse peut éprouver des difficultés à synchroniser le mouvement de ses pieds avec celui de ses bras qui est caractéristique de la variante de Baud et qui correspond à ce qui est dansé de nos jours en fest noz. Je vous donne quelques détails.
Même si elle est la plus connue du fait de son nom français, ce n’est pas à la gavotte à laquelle pensent les touristes se rendant en Bretagne. Ils ont en tête l’image d’une danse se dansant en cercle, certes, mais qui comporte des mouvements de bras et où les danseurs se tiennent par le petit doigt. En réalité, il s’agit là de l’an dro (que l’on peut traduire par « la ronde » ou « le tour » en français). Cette danse peut aussi se faire en chaîne ouverte où les hommes et les femmes sont alternés et se tiennent effectivement par le petit doigt. Le néophyte en danse peut éprouver des difficultés à synchroniser le mouvement de ses pieds avec celui de ses bras qui est caractéristique de la variante de Baud et qui correspond à ce qui est dansé de nos jours en fest noz. Je vous donne quelques détails.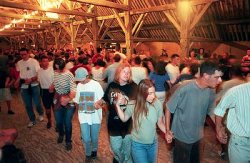 Depuis années 40 et encore davantage après la Seconde Guerre mondiale, les cercles celtiques et les groupes de loisirs déforment (volontairement ou non) les danses que leurs danseurs pratiquent. Ils créent ainsi de nouvelles danses et variantes. L’invention de nouvelles danses a aussi été parfois faite en contradiction avec le support musical traditionnel (on effectue des pas sur une musique qui n’y est traditionnellement pas associée). Le renouveau de la danse traditionnelle bretonne se fait en partie grâce au chanteur et harpiste Alan Stivell (dont l’une des mélodies connues a été reprise dans les années 90 par le groupe Manau) qui, par la musique et ses prises de position, affirma sa culture et l’identité de ses racines. Après 1970, l’évolution des musiques populaires amena le remplacement du chant dans les festoù noz par des formations musicales où apparaissent les guitares électriques. Une petite précision : festoù noz est le pluriel de fest noz, une fête en soirée. Si la fête se passe le jour, on appelle cela un fest deiz (« fête de jour »). Ces fêtes traditionnelles sont devenues un vecteur de transmission non seulement des danses bretonnes, mais aussi de la musique bretonne. Ces rassemblements se font comme les soirées de danses à deux, il s’agit d’une sortie de loisir pour se divertir et voir du monde dans une ambiance festive. Le mot fest noz dépasse aujourd’hui les limites de la Bretagne puisqu’on qualifie parfois de fest noz les bals folk d’autres régions où d’autres danses traditionnelles sont pratiquées (mazurka, polka, scottich, bourrée, etc.). Ces rendez-vous familiaux et populaires ouverts à tous semblent être très positif, cependant ils ont produit des effets pervers sur les danses des origines par un gommage des difficultés techniques, l’uniformisation des gestes lorsque des cours d’initiation sont donnés, etc. En même temps, on voit parfois la disparition des rituels de danse dans les festoù noz (disparition du meneur, attitude légère vis-à-vis des traditions, perte de respect, etc.). De même, on assiste à la dissociation entre la musique et chant d’un côté et la danse de l’autre côté.
Depuis années 40 et encore davantage après la Seconde Guerre mondiale, les cercles celtiques et les groupes de loisirs déforment (volontairement ou non) les danses que leurs danseurs pratiquent. Ils créent ainsi de nouvelles danses et variantes. L’invention de nouvelles danses a aussi été parfois faite en contradiction avec le support musical traditionnel (on effectue des pas sur une musique qui n’y est traditionnellement pas associée). Le renouveau de la danse traditionnelle bretonne se fait en partie grâce au chanteur et harpiste Alan Stivell (dont l’une des mélodies connues a été reprise dans les années 90 par le groupe Manau) qui, par la musique et ses prises de position, affirma sa culture et l’identité de ses racines. Après 1970, l’évolution des musiques populaires amena le remplacement du chant dans les festoù noz par des formations musicales où apparaissent les guitares électriques. Une petite précision : festoù noz est le pluriel de fest noz, une fête en soirée. Si la fête se passe le jour, on appelle cela un fest deiz (« fête de jour »). Ces fêtes traditionnelles sont devenues un vecteur de transmission non seulement des danses bretonnes, mais aussi de la musique bretonne. Ces rassemblements se font comme les soirées de danses à deux, il s’agit d’une sortie de loisir pour se divertir et voir du monde dans une ambiance festive. Le mot fest noz dépasse aujourd’hui les limites de la Bretagne puisqu’on qualifie parfois de fest noz les bals folk d’autres régions où d’autres danses traditionnelles sont pratiquées (mazurka, polka, scottich, bourrée, etc.). Ces rendez-vous familiaux et populaires ouverts à tous semblent être très positif, cependant ils ont produit des effets pervers sur les danses des origines par un gommage des difficultés techniques, l’uniformisation des gestes lorsque des cours d’initiation sont donnés, etc. En même temps, on voit parfois la disparition des rituels de danse dans les festoù noz (disparition du meneur, attitude légère vis-à-vis des traditions, perte de respect, etc.). De même, on assiste à la dissociation entre la musique et chant d’un côté et la danse de l’autre côté. Comme pour beaucoup de danses traditionnelles, si nous pouvons encore danser ces danses traditionnelles bretonnes, c’est grâce aux efforts de collectage qui ont été faits du temps où il y avait encore des survivants connaissant les danses des origines. Il y a toujours une opposition entre les partisans de la tradition intacte des origines et ceux qui pensent que les danses ne vivent que si elles sont pratiquées et si elles évoluent selon leur contexte de pratique dans le temps. Là-dessus, je vous laisse réfléchir… L’été est passé et vous aurez peut-être manqué quelques festoù noz lors de vos vacances en Bretagne. Néanmoins, jetez un oeil à côté de chez vous : il y a sûrement un groupe d’irréductibles Bretons expatriés qui vous accueilleront avec plaisir. Il y en a partout, même où je vis à présent, dans le Sud-Ouest toulousain…
Comme pour beaucoup de danses traditionnelles, si nous pouvons encore danser ces danses traditionnelles bretonnes, c’est grâce aux efforts de collectage qui ont été faits du temps où il y avait encore des survivants connaissant les danses des origines. Il y a toujours une opposition entre les partisans de la tradition intacte des origines et ceux qui pensent que les danses ne vivent que si elles sont pratiquées et si elles évoluent selon leur contexte de pratique dans le temps. Là-dessus, je vous laisse réfléchir… L’été est passé et vous aurez peut-être manqué quelques festoù noz lors de vos vacances en Bretagne. Néanmoins, jetez un oeil à côté de chez vous : il y a sûrement un groupe d’irréductibles Bretons expatriés qui vous accueilleront avec plaisir. Il y en a partout, même où je vis à présent, dans le Sud-Ouest toulousain…
 Pour marquer la saison chaude, je vous propose de partir dans les îles. Non, pas l’île de Ré ou la Corse, mais beaucoup plus loin, dans l’océan Pacifique. Je vous emmène aujourd’hui à Tahiti, collectivité d’outre-mer faisant partie de la Polynésie française. Aussi loin que je me souvienne, c’est là — j’y ai vécu 2 ans — que j’ai fait, étant enfant, mes premiers pas de danse en apprenant à l’école ce que la majorité des Français métropolitains connaissent sous le nom de tamure (prononcer « tamouré »). Il est temps pour moi de vous faire découvrir cela avec un soupçon de culture tahitienne.
Pour marquer la saison chaude, je vous propose de partir dans les îles. Non, pas l’île de Ré ou la Corse, mais beaucoup plus loin, dans l’océan Pacifique. Je vous emmène aujourd’hui à Tahiti, collectivité d’outre-mer faisant partie de la Polynésie française. Aussi loin que je me souvienne, c’est là — j’y ai vécu 2 ans — que j’ai fait, étant enfant, mes premiers pas de danse en apprenant à l’école ce que la majorité des Français métropolitains connaissent sous le nom de tamure (prononcer « tamouré »). Il est temps pour moi de vous faire découvrir cela avec un soupçon de culture tahitienne. L’imaginaire collectif est très vivant par rapport à Tahiti : des grandes plages désertes, des cocotiers, la mer bleue turquoise, sans oublier les vahines (prononcer « vahiné ») qui, au son des ukuleles, dansent le « tamouré » vêtues d’un soutien-gorge en noix de coco, un pagne en feuilles de bananier et la fleur de tiaré fixée au-dessus d’une oreille. C’est très caricatural, évidemment. En réalité, la danse tahitienne doit être appelée ‘ori tahiti (le mot ori signifie « danse » en tahitien). Mais d’où provient donc alors cette histoire de tamure ? Le tamure est à l’origine un poisson de la famille des becs de cane et présent dans les archipels de la Société et des Tuamotu. Une chanson fut composée après la Seconde Guerre mondiale avec le mot tamure dans son refrain. Comme sa mélodie était basée sur les rythmes traditionnels tahitiens, on eut tôt fait d’associer le nom du poisson à ceux-ci ainsi que, par ricochet, à la danse qu’on pouvait effectuer dessus. Il existe toutefois une autre hypothèse quant à l’utilisation de ce mot : il semble que Cook ait décrit des danses indécentes qu’il appelle « timorodee » vers 1780 et qu’il utilisait donc le mot tamure en l’ayant déformé.
L’imaginaire collectif est très vivant par rapport à Tahiti : des grandes plages désertes, des cocotiers, la mer bleue turquoise, sans oublier les vahines (prononcer « vahiné ») qui, au son des ukuleles, dansent le « tamouré » vêtues d’un soutien-gorge en noix de coco, un pagne en feuilles de bananier et la fleur de tiaré fixée au-dessus d’une oreille. C’est très caricatural, évidemment. En réalité, la danse tahitienne doit être appelée ‘ori tahiti (le mot ori signifie « danse » en tahitien). Mais d’où provient donc alors cette histoire de tamure ? Le tamure est à l’origine un poisson de la famille des becs de cane et présent dans les archipels de la Société et des Tuamotu. Une chanson fut composée après la Seconde Guerre mondiale avec le mot tamure dans son refrain. Comme sa mélodie était basée sur les rythmes traditionnels tahitiens, on eut tôt fait d’associer le nom du poisson à ceux-ci ainsi que, par ricochet, à la danse qu’on pouvait effectuer dessus. Il existe toutefois une autre hypothèse quant à l’utilisation de ce mot : il semble que Cook ait décrit des danses indécentes qu’il appelle « timorodee » vers 1780 et qu’il utilisait donc le mot tamure en l’ayant déformé.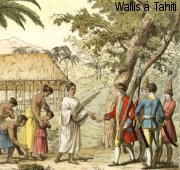 Lorsque les explorateurs Wallis, Bougainville (qui qualifia l’île de « Paradis terrestre » à son premier voyage) et Cook se rendirent (successivement) à Tahiti à partir de 1767, ils y virent des habitants vivant dans une société hiérarchisée, où les conflits étaient fréquents, où des actes de cannibalisme existaient, où le corps et les relations sexuelles n’étaient pas contraints. Ils remarquèrent particulièrement que les femmes dansaient nues ou presque. On pense bien que les premiers missionnaires protestants qui arrivèrent sur l’île en 1797 ont eu tôt fait de combattre ces gestes indécents et ces danses lascives, en particulier l’upa upa qui se dansait en couple.
Lorsque les explorateurs Wallis, Bougainville (qui qualifia l’île de « Paradis terrestre » à son premier voyage) et Cook se rendirent (successivement) à Tahiti à partir de 1767, ils y virent des habitants vivant dans une société hiérarchisée, où les conflits étaient fréquents, où des actes de cannibalisme existaient, où le corps et les relations sexuelles n’étaient pas contraints. Ils remarquèrent particulièrement que les femmes dansaient nues ou presque. On pense bien que les premiers missionnaires protestants qui arrivèrent sur l’île en 1797 ont eu tôt fait de combattre ces gestes indécents et ces danses lascives, en particulier l’upa upa qui se dansait en couple.  La seule exception dans le domaine de l’indécence était le hura, une danse ancienne, qui pratiquée dans un habit richement élaboré. Tahiti est massivement convertie au christianisme en 1815 et en 1842 arrivent les Français qui autorisent les danses du pays (mais avec modération et décence). La Fête nationale est établie le 14 juillet 1881 tout comme en France et cela correspond aux fêtes de Tiurai (les fêtes de juillet). C’est dans ce cadre que la danse regagne peu à peu du terrain aux côtés des himene, les chants traditionnels. Sortant de sa clandestinité, la danse refait surface à partir de 1956 avec le réveil de la conscience culturelle polynésienne et sous l’impulsion de Madeleine Mou’a. Suite à un séjour en France métropolitaine où elle a vu des groupes folkloriques auvergnats, cette institutrice décide de créer l’équivalent à son retour à Tahiti en créant le groupe Heiva.
La seule exception dans le domaine de l’indécence était le hura, une danse ancienne, qui pratiquée dans un habit richement élaboré. Tahiti est massivement convertie au christianisme en 1815 et en 1842 arrivent les Français qui autorisent les danses du pays (mais avec modération et décence). La Fête nationale est établie le 14 juillet 1881 tout comme en France et cela correspond aux fêtes de Tiurai (les fêtes de juillet). C’est dans ce cadre que la danse regagne peu à peu du terrain aux côtés des himene, les chants traditionnels. Sortant de sa clandestinité, la danse refait surface à partir de 1956 avec le réveil de la conscience culturelle polynésienne et sous l’impulsion de Madeleine Mou’a. Suite à un séjour en France métropolitaine où elle a vu des groupes folkloriques auvergnats, cette institutrice décide de créer l’équivalent à son retour à Tahiti en créant le groupe Heiva. La danse est particulièrement à l’honneur lors du Tiurai où des concours de danse sont organisés. En 1984, le Tiurai est renommé Heiva (toujours au mois de juillet) et cela marque aussi le début d’une certaine codification des mouvements de la danse.
La danse est particulièrement à l’honneur lors du Tiurai où des concours de danse sont organisés. En 1984, le Tiurai est renommé Heiva (toujours au mois de juillet) et cela marque aussi le début d’une certaine codification des mouvements de la danse.
 De nos jours, la danse tahitienne continue d’évoluer. De grands groupes comme les Grands Ballets de Tahiti (photo ci-contre) y incorporent de la nouveauté sous la forme de mouvements issus de la danse contemporaine ou de la danse classique. L’opposition entre tradition et modernité est donc présente dans certaines chorégraphies modernes de ‘ori tahiti. Par ailleurs, la danse est naturellement influencée par d’autres formes de danse traditionnelle comme le hula venu de Hawaii. Depuis la fin du XXe siècle, les danses traditionnelles tahitiennes connaissent de nouveau une grande popularité et un grand nombre d’écoles de danse voient le jour. La musique est aujourd’hui jouée par des tambours polynésiens (je passe ici sous silence les noms des instruments en tahitien, peu familiers en dehors de la Polynésie), des flûtes nasales, des guitares, de ukuleles et parfois du didgeridoo et d’autres instruments traditionnels comme le pu, la conque marine, qui marque souvent le début d’une prestation. Les costumes contemporains sont divisés en trois types : le grand costume (souvent porté en début de spectacle et marqué par sa grande jupe en fils d’écorce d’hibiscus et sa coiffe), le costume végétal (marqué par la couleur verte des feuilles de végétaux qui le composent) et le costume en tissu (marqué par le paréo de tissu imprimé de motifs polynésiens et parfois de la couronne de fleurs).
De nos jours, la danse tahitienne continue d’évoluer. De grands groupes comme les Grands Ballets de Tahiti (photo ci-contre) y incorporent de la nouveauté sous la forme de mouvements issus de la danse contemporaine ou de la danse classique. L’opposition entre tradition et modernité est donc présente dans certaines chorégraphies modernes de ‘ori tahiti. Par ailleurs, la danse est naturellement influencée par d’autres formes de danse traditionnelle comme le hula venu de Hawaii. Depuis la fin du XXe siècle, les danses traditionnelles tahitiennes connaissent de nouveau une grande popularité et un grand nombre d’écoles de danse voient le jour. La musique est aujourd’hui jouée par des tambours polynésiens (je passe ici sous silence les noms des instruments en tahitien, peu familiers en dehors de la Polynésie), des flûtes nasales, des guitares, de ukuleles et parfois du didgeridoo et d’autres instruments traditionnels comme le pu, la conque marine, qui marque souvent le début d’une prestation. Les costumes contemporains sont divisés en trois types : le grand costume (souvent porté en début de spectacle et marqué par sa grande jupe en fils d’écorce d’hibiscus et sa coiffe), le costume végétal (marqué par la couleur verte des feuilles de végétaux qui le composent) et le costume en tissu (marqué par le paréo de tissu imprimé de motifs polynésiens et parfois de la couronne de fleurs). La langue tahitienne appartient à une famille de plus de 400 langues parlées dans une zone géographique s’étendant de Madagascar à l’île de Pâques. Ce sont les langues malayo-polynésiennes. Comme la Polynésie française est en relation étroite avec la France, certains mots tahitiens sont passés dans le langage courant des métropolitains ou, en tout cas, sont devenus familiers même pour ceux qui n’ont jamais fait le voyage jusqu’à l’île. En voici quelques exemples ci-après. Notez que le « e » se prononce « é » et que le « u » se prononce « ou ».
La langue tahitienne appartient à une famille de plus de 400 langues parlées dans une zone géographique s’étendant de Madagascar à l’île de Pâques. Ce sont les langues malayo-polynésiennes. Comme la Polynésie française est en relation étroite avec la France, certains mots tahitiens sont passés dans le langage courant des métropolitains ou, en tout cas, sont devenus familiers même pour ceux qui n’ont jamais fait le voyage jusqu’à l’île. En voici quelques exemples ci-après. Notez que le « e » se prononce « é » et que le « u » se prononce « ou ».
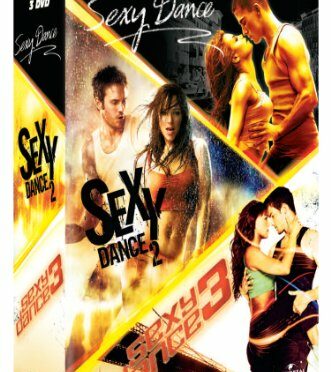
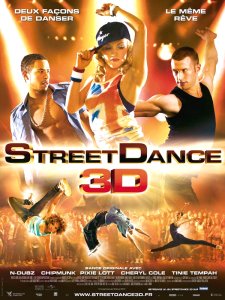 Le 19 mai dernier est sorti un nouveau film sur le thème de la danse : « Street dance 3D ». Vous me direz : un film de plus où s’opposent des idées préconçues et qui se finit en happy end. Peut-être. Mais la particularité de celui-là est qu’il s’agit du premier film en 3D, comme son titre le suggère fortement. C’est aussi pour moi l’occasion de faire une petite mise au point sur cette histoire de 3D.
Le 19 mai dernier est sorti un nouveau film sur le thème de la danse : « Street dance 3D ». Vous me direz : un film de plus où s’opposent des idées préconçues et qui se finit en happy end. Peut-être. Mais la particularité de celui-là est qu’il s’agit du premier film en 3D, comme son titre le suggère fortement. C’est aussi pour moi l’occasion de faire une petite mise au point sur cette histoire de 3D.



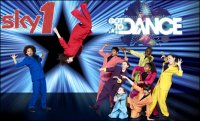 Côté danse, j’ai trouvé les chorégraphies plutôt bonnes dans l’ensemble (mais sans plus pour certaines…). Cela est en fait dû à la manière dont cela a été filmé. Dans l’absolu, il y avait de bons moments, mais ils ont parfois été gâchés par un éclairage mal fait ou des déplacements de caméra qui desservent la danse au lieu de la servir… À noter la présence dans ce film des groupes Flawless (qui a participé à « Britain’s Got Talent », la version anglaise de l’émission « Incroyable talent ») et Diversity (qui a remporté le casting de la même émission). Tiens, tant que j’y suis, le leader de la troupe Diversity peut être vu sur le petit écran également en ce moment. Ashley Banjo fait office de jury dans la saison 1 (2009-2010) de l’émission « Got to Dance », émission anglaise de casting de danseurs, initialement diffusée sur Sky 1, mais (oh surprise !) également diffusée doublée en français sur Gulli (chaîne 18 de la TNT) tous les jeudis à 20h30 depuis le jeudi 27 mai 2010. Les deux autres membres du jury sont Kimberly Wyatt (membre des Pussycat Dolls) et Adam Garcia (danseur à claquettes d’origine australienne).
Côté danse, j’ai trouvé les chorégraphies plutôt bonnes dans l’ensemble (mais sans plus pour certaines…). Cela est en fait dû à la manière dont cela a été filmé. Dans l’absolu, il y avait de bons moments, mais ils ont parfois été gâchés par un éclairage mal fait ou des déplacements de caméra qui desservent la danse au lieu de la servir… À noter la présence dans ce film des groupes Flawless (qui a participé à « Britain’s Got Talent », la version anglaise de l’émission « Incroyable talent ») et Diversity (qui a remporté le casting de la même émission). Tiens, tant que j’y suis, le leader de la troupe Diversity peut être vu sur le petit écran également en ce moment. Ashley Banjo fait office de jury dans la saison 1 (2009-2010) de l’émission « Got to Dance », émission anglaise de casting de danseurs, initialement diffusée sur Sky 1, mais (oh surprise !) également diffusée doublée en français sur Gulli (chaîne 18 de la TNT) tous les jeudis à 20h30 depuis le jeudi 27 mai 2010. Les deux autres membres du jury sont Kimberly Wyatt (membre des Pussycat Dolls) et Adam Garcia (danseur à claquettes d’origine australienne). Et la 3D dans tout cela ? Si les producteurs ont mis cette mention dans le titre, c’est que ça doit être important… Dans les faits, cette « 3D » se concrétise par une simple sensation de profondeur dans une image qui semble composée de différents plans plats. On ne sent pas le volume (à part dans de rares scènes comme les scènes de transition dans la ville ou la battle dans le bar). En tout cas, grosse déception. Pas d’image surgissant hors de l’écran, ni d’impression de faire partie de la scène de danse. Bref, rien à voir avec des films réellement tournés grâce à des caméras spéciales. Il y a même certaines scènes où la lumière « éblouissante » de certains spots lumineux qui était censée donner un effet spécial en 2D rend l’image impossible à distinguer avec des lunettes 3D. Car je mettrais ma main au feu que nous avons ici affaire à une « 3D relief » créée en post-production à partir d’un film classique en 2D. D’ailleurs, je pense qu’il vaut mieux voir ce film directement dans sa version « normale ». La 3D n’apporte rien ici, et ne sert qu’à distraire le spectateur et à réduire son champ de vision (les bords de mes lunettes aux verres polarisés m’ont plutôt gêné qu’autre chose). Donc cette troisième dimension n’est qu’une illusion et un argument marketing.
Et la 3D dans tout cela ? Si les producteurs ont mis cette mention dans le titre, c’est que ça doit être important… Dans les faits, cette « 3D » se concrétise par une simple sensation de profondeur dans une image qui semble composée de différents plans plats. On ne sent pas le volume (à part dans de rares scènes comme les scènes de transition dans la ville ou la battle dans le bar). En tout cas, grosse déception. Pas d’image surgissant hors de l’écran, ni d’impression de faire partie de la scène de danse. Bref, rien à voir avec des films réellement tournés grâce à des caméras spéciales. Il y a même certaines scènes où la lumière « éblouissante » de certains spots lumineux qui était censée donner un effet spécial en 2D rend l’image impossible à distinguer avec des lunettes 3D. Car je mettrais ma main au feu que nous avons ici affaire à une « 3D relief » créée en post-production à partir d’un film classique en 2D. D’ailleurs, je pense qu’il vaut mieux voir ce film directement dans sa version « normale ». La 3D n’apporte rien ici, et ne sert qu’à distraire le spectateur et à réduire son champ de vision (les bords de mes lunettes aux verres polarisés m’ont plutôt gêné qu’autre chose). Donc cette troisième dimension n’est qu’une illusion et un argument marketing. Je profite d’aborder ce sujet pour faire un aparté sur cette notion de 3D au cinéma. En réalité, on devrait parler d’un film en relief et non d’un film en 3D. Le relief est ce que l’on perçoit quand on regarde des films comme Street Dance 3D, Avatar, etc. Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore bien les techniques de rendu en relief utilisées au cinéma, voici un petit résumé. On rencontre actuellement trois méthodes.
Je profite d’aborder ce sujet pour faire un aparté sur cette notion de 3D au cinéma. En réalité, on devrait parler d’un film en relief et non d’un film en 3D. Le relief est ce que l’on perçoit quand on regarde des films comme Street Dance 3D, Avatar, etc. Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore bien les techniques de rendu en relief utilisées au cinéma, voici un petit résumé. On rencontre actuellement trois méthodes.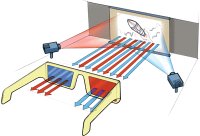 Toutes ces méthodes ont un point commun : chaque oeil reçoit une image différente pour donner la sensation de relief. Cela signifie aussi que, peu importe l’endroit où l’on se trouve dans la salle, on reçoit les mêmes images et donc le même angle de vision sur le film. D’où mon propos sur la différence entre la 3D et le relief. Si l’on avait une technologie destinée à projeter de la vraie 3D, un spectateur à gauche de la salle de cinéma ne verrait pas la même chose qu’un autre situé à droite. Pour vous donner une idée de ce que je veux dire, la technologie des hologrammes pourrait s’approcher de cela : selon où l’on se trouve par rapport à l’hologramme, on le voit un angle différent. Lorsque je crée mes danseurs pour mes livres de technique dans mon ordinateur, je les manipule en 3D (eh oui, on peut aussi savoir faire autre chose que danser…) et je choisis l’angle de vue qui le plaît le mieux pour en faire une image intégrée dans le livre. Ce n’est donc évidemment pas là une image en 3D, mais c’est une image conçue par une technique 3D.
Toutes ces méthodes ont un point commun : chaque oeil reçoit une image différente pour donner la sensation de relief. Cela signifie aussi que, peu importe l’endroit où l’on se trouve dans la salle, on reçoit les mêmes images et donc le même angle de vision sur le film. D’où mon propos sur la différence entre la 3D et le relief. Si l’on avait une technologie destinée à projeter de la vraie 3D, un spectateur à gauche de la salle de cinéma ne verrait pas la même chose qu’un autre situé à droite. Pour vous donner une idée de ce que je veux dire, la technologie des hologrammes pourrait s’approcher de cela : selon où l’on se trouve par rapport à l’hologramme, on le voit un angle différent. Lorsque je crée mes danseurs pour mes livres de technique dans mon ordinateur, je les manipule en 3D (eh oui, on peut aussi savoir faire autre chose que danser…) et je choisis l’angle de vue qui le plaît le mieux pour en faire une image intégrée dans le livre. Ce n’est donc évidemment pas là une image en 3D, mais c’est une image conçue par une technique 3D.
 J’ai eu un peu de mal à trouver un titre parlant pour cet article. En fait, je vais essayer de parcourir rapidement les divers moyens utilisés en un siècle pour diffuser de la musique lors de soirées dansantes ou de cours de danse. En effet, tous les adolescents d’aujourd’hui n’ont jamais rien connu avant le CD audio et les enfants encore plus jeunes auront tous toujours connu la musique au format numérique. Petit retour en arrière…
J’ai eu un peu de mal à trouver un titre parlant pour cet article. En fait, je vais essayer de parcourir rapidement les divers moyens utilisés en un siècle pour diffuser de la musique lors de soirées dansantes ou de cours de danse. En effet, tous les adolescents d’aujourd’hui n’ont jamais rien connu avant le CD audio et les enfants encore plus jeunes auront tous toujours connu la musique au format numérique. Petit retour en arrière…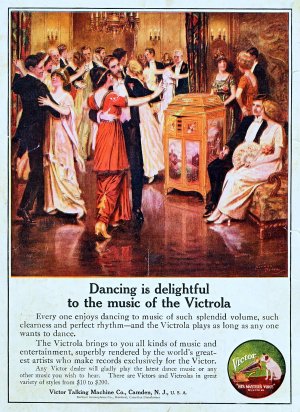 Le développement du marché du disque se fait à partir de 1902 (le cylindre est peu à peu abandonné) et la durée d’un disque est portée de 2 à 4 minutes en 1908, mais ce n’est qu’en 1926 que cette durée est couplée avec le procédé de gravure électrique qui apportait un gain substantiel en qualité. Je passe ici sur les divers progrès autour de ce support comme le microsillon dans les années 50.
Le développement du marché du disque se fait à partir de 1902 (le cylindre est peu à peu abandonné) et la durée d’un disque est portée de 2 à 4 minutes en 1908, mais ce n’est qu’en 1926 que cette durée est couplée avec le procédé de gravure électrique qui apportait un gain substantiel en qualité. Je passe ici sur les divers progrès autour de ce support comme le microsillon dans les années 50.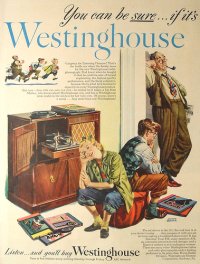 Ce matériel (aussi appelé pick-up) était entièrement contenu dans une petite valise dont le couvercle logeait les haut-parleurs. Le matériel fixe a par la suite été appelé « platine » avec l’apparition des chaînes hi-fi et n’intégrait plus les éléments d’amplification et les haut-parleurs. Dans les lieux publics, les années 30 voient apparaître les juke-box, armoires intégrant un système de choix de disques à la demande, mais ce sont les modèles bariolés des années 50 qui restent dans les mémoires. Servant aussi à diffuser de la musique, mais intégrant aussi un système diffusant des clips, on passe des Panoram des années 40 (avec des petits films en noir et blanc appelés soundies) aux scopitones (terme désignant aussi les clips qui y étaient proposés) dans les années 60. Voilà donc en quelques lignes ce qui permettait aux gens de diffuser de la musique pour danser en privé ou en public. Dans les années 30 et 40, on connaît l’âge d’or des big bands (pour qui la musique swing est reine) composés de nombreux musiciens alors que dans les années 50 et 60, les orchestres sont de taille modeste et le rock’n’roll est à son apogée. C’est la fameuse époque des yéyés.
Ce matériel (aussi appelé pick-up) était entièrement contenu dans une petite valise dont le couvercle logeait les haut-parleurs. Le matériel fixe a par la suite été appelé « platine » avec l’apparition des chaînes hi-fi et n’intégrait plus les éléments d’amplification et les haut-parleurs. Dans les lieux publics, les années 30 voient apparaître les juke-box, armoires intégrant un système de choix de disques à la demande, mais ce sont les modèles bariolés des années 50 qui restent dans les mémoires. Servant aussi à diffuser de la musique, mais intégrant aussi un système diffusant des clips, on passe des Panoram des années 40 (avec des petits films en noir et blanc appelés soundies) aux scopitones (terme désignant aussi les clips qui y étaient proposés) dans les années 60. Voilà donc en quelques lignes ce qui permettait aux gens de diffuser de la musique pour danser en privé ou en public. Dans les années 30 et 40, on connaît l’âge d’or des big bands (pour qui la musique swing est reine) composés de nombreux musiciens alors que dans les années 50 et 60, les orchestres sont de taille modeste et le rock’n’roll est à son apogée. C’est la fameuse époque des yéyés. Continuons donc notre parcours chronologique avec le passage de l’analogique au numérique. Je n’oublie évidemment pas l’étape de l’apparition du premier magnétophone à cassettes en 1963 qui révolutionne le domaine en terme de portabilité. L’avantage de ce système à bande magnétique est qu’il est réenregistrable et compact. Cela conduit naturellement à l’invention du baladeur (sous le nom walkman) par Sony en 1979, donnant une certaine liberté aux amateurs de musique et de danse. On peut alors danser le disco ou faire du roller sur ses morceaux préférés. Sur une cassette, on stocke alors de 60 à 180 minutes de musique alors que sur les disques à 33 tours on en trouvait que de 40 à 60 minutes. C’est toujours Sony, associé à Philips, qui en 1983 signe le passage au son enregistré numériquement en créant le disque compact (CD). Ici, on ne stocke que 74 minutes de musique (650 Mo), mais le support est réputé inusable (surtout vis-à-vis de la K7 audio qui est sensible aux ondes magnétiques). La platine CD est aussi déclinée en version baladeur, cela va de soi. Le système du CD audio est encore énormément utilisé de nos jours. Beaucoup d’enseignants et DJ utilisent ce support dans des platines spéciales où l’on peut faire varier la vitesse de la musique (comme la ralentir pour travailler une chorégraphie sur le bon morceau, mais sans trop stresser… ou encore passer d’un titre à un autre tout en douceur au niveau du tempo).
Continuons donc notre parcours chronologique avec le passage de l’analogique au numérique. Je n’oublie évidemment pas l’étape de l’apparition du premier magnétophone à cassettes en 1963 qui révolutionne le domaine en terme de portabilité. L’avantage de ce système à bande magnétique est qu’il est réenregistrable et compact. Cela conduit naturellement à l’invention du baladeur (sous le nom walkman) par Sony en 1979, donnant une certaine liberté aux amateurs de musique et de danse. On peut alors danser le disco ou faire du roller sur ses morceaux préférés. Sur une cassette, on stocke alors de 60 à 180 minutes de musique alors que sur les disques à 33 tours on en trouvait que de 40 à 60 minutes. C’est toujours Sony, associé à Philips, qui en 1983 signe le passage au son enregistré numériquement en créant le disque compact (CD). Ici, on ne stocke que 74 minutes de musique (650 Mo), mais le support est réputé inusable (surtout vis-à-vis de la K7 audio qui est sensible aux ondes magnétiques). La platine CD est aussi déclinée en version baladeur, cela va de soi. Le système du CD audio est encore énormément utilisé de nos jours. Beaucoup d’enseignants et DJ utilisent ce support dans des platines spéciales où l’on peut faire varier la vitesse de la musique (comme la ralentir pour travailler une chorégraphie sur le bon morceau, mais sans trop stresser… ou encore passer d’un titre à un autre tout en douceur au niveau du tempo).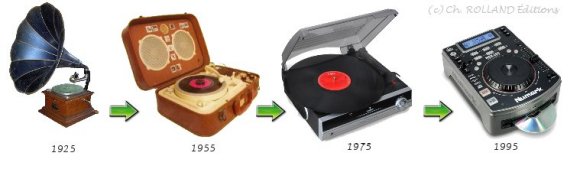
 Par rapport au format numérique du CD audio (PCM/WAV/CDA), le format MP3 est compressé. Autrement dit, le son est traité de manière à prendre moins de place une fois stocké. Il faut donc obligatoirement le décompresser via des calculs complexes avant de pouvoir l’écouter. Dans un fichier MP3, le son peut être plus ou moins compressé, mais le gain de place se fait au détriment de la qualité audio.
Par rapport au format numérique du CD audio (PCM/WAV/CDA), le format MP3 est compressé. Autrement dit, le son est traité de manière à prendre moins de place une fois stocké. Il faut donc obligatoirement le décompresser via des calculs complexes avant de pouvoir l’écouter. Dans un fichier MP3, le son peut être plus ou moins compressé, mais le gain de place se fait au détriment de la qualité audio.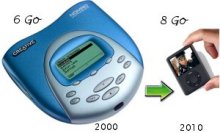 Voici donc que le son est dématérialisé et extrêmement portable. D’ailleurs, il ne reste pas dans les ordinateurs et les premiers lecteurs MP3 portables ont tôt fait d’apparaître en 1999. Des fabricants comme Saehan, Rio et Creative démarquent alors par leurs produits. Comme les mémoires de type flash (mémoire qui ne s’efface pas lorsqu’on éteint l’appareil) n’atteignaient pas encore les capacités que nous connaissons aujourd’hui, ces baladeurs contenaient un disque dur où l’on enregistrait les fichiers audio en MP3. J’ai moi-même acheté l’un de ces appareils en 2000 sous la forme du Creative Nomad DAP Jukebox avec un disque dur de 6 Go. À l’époque, c’était l’appareil rêvé pour gérer la musique pour mes cours de danse et les fonctions EAX me permettaient même de réduire la vitesse d’un morceau sans faire varier la hauteur du son.
Voici donc que le son est dématérialisé et extrêmement portable. D’ailleurs, il ne reste pas dans les ordinateurs et les premiers lecteurs MP3 portables ont tôt fait d’apparaître en 1999. Des fabricants comme Saehan, Rio et Creative démarquent alors par leurs produits. Comme les mémoires de type flash (mémoire qui ne s’efface pas lorsqu’on éteint l’appareil) n’atteignaient pas encore les capacités que nous connaissons aujourd’hui, ces baladeurs contenaient un disque dur où l’on enregistrait les fichiers audio en MP3. J’ai moi-même acheté l’un de ces appareils en 2000 sous la forme du Creative Nomad DAP Jukebox avec un disque dur de 6 Go. À l’époque, c’était l’appareil rêvé pour gérer la musique pour mes cours de danse et les fonctions EAX me permettaient même de réduire la vitesse d’un morceau sans faire varier la hauteur du son.  De nos jours, on a des appareils qui tiennent au creux de la main pour faire la même chose et une mémoire micro-HD de 8Go est plus petite qu’un ongle… Les enseignants utilisent ces appareils (beaucoup ont des iPods ou des appareils similaires) pour se déplacer avec leur CDthèque sur eux alors que d’autres préfèrent encore le grand écran d’un ordinateur portable associé à son disque dur (éventuellement externe) plein de MP3 comme c’est souvent le cas pour les DJ. On a même des platines DJ virtuelles connectables en USB à un ordinateur qui permet de retrouver le toucher des platines CD sans avoir à manipuler des dizaines de disques en une seule soirée.
De nos jours, on a des appareils qui tiennent au creux de la main pour faire la même chose et une mémoire micro-HD de 8Go est plus petite qu’un ongle… Les enseignants utilisent ces appareils (beaucoup ont des iPods ou des appareils similaires) pour se déplacer avec leur CDthèque sur eux alors que d’autres préfèrent encore le grand écran d’un ordinateur portable associé à son disque dur (éventuellement externe) plein de MP3 comme c’est souvent le cas pour les DJ. On a même des platines DJ virtuelles connectables en USB à un ordinateur qui permet de retrouver le toucher des platines CD sans avoir à manipuler des dizaines de disques en une seule soirée. Cela représente des heures et des heures d’écoute, de recherche et de classement afin de trouver les titres de qualité pour danser. Parfois, cela a nécessité des jours, des efforts importants et de l’argent pour acquérir un seul disque ou un CD donné. Ainsi lorsque vous demandez à un professionnel s’il peut vous donner une copie d’un disque ou un CD qu’il a utilisé en soirée ou en cours, vous comprendrez aisément qu’il puisse vous dire non. La première raison de ce refus est, je viens de le dire, que c’est un investissement pour lui. La seconde raison est légale, évidemment. Il vaut mieux que vous achetiez vous-même votre musique. En tout état de cause, un enseignant ou un DJ vous donnera probablement volontiers le nom et l’artiste d’un titre ou d’un album pour que vous puissiez vous le procurer en toute légalité. Sinon, si vous aimez danser sur bon son, vous pouvez aussi guetter les soirées avec orchestre ou les concerts où il y a de la place pour danser. Quel bonheur lorsqu’une soirée est organisée au son d’un véritable orchestre en direct live ! Pour ma part, je préfère largement cela à une soirée aux morceaux certes de styles très variés, mais à base de MP3 d’une qualité sonore se rapprochant des cynlindres des années 20… Et là, j’exagère à peine, car j’ai parfois l’impression de ce retour en arrière à cause de DJ qui utilisent mal la technologie ou qui ont négligé d’acheter légalement leur musique…
Cela représente des heures et des heures d’écoute, de recherche et de classement afin de trouver les titres de qualité pour danser. Parfois, cela a nécessité des jours, des efforts importants et de l’argent pour acquérir un seul disque ou un CD donné. Ainsi lorsque vous demandez à un professionnel s’il peut vous donner une copie d’un disque ou un CD qu’il a utilisé en soirée ou en cours, vous comprendrez aisément qu’il puisse vous dire non. La première raison de ce refus est, je viens de le dire, que c’est un investissement pour lui. La seconde raison est légale, évidemment. Il vaut mieux que vous achetiez vous-même votre musique. En tout état de cause, un enseignant ou un DJ vous donnera probablement volontiers le nom et l’artiste d’un titre ou d’un album pour que vous puissiez vous le procurer en toute légalité. Sinon, si vous aimez danser sur bon son, vous pouvez aussi guetter les soirées avec orchestre ou les concerts où il y a de la place pour danser. Quel bonheur lorsqu’une soirée est organisée au son d’un véritable orchestre en direct live ! Pour ma part, je préfère largement cela à une soirée aux morceaux certes de styles très variés, mais à base de MP3 d’une qualité sonore se rapprochant des cynlindres des années 20… Et là, j’exagère à peine, car j’ai parfois l’impression de ce retour en arrière à cause de DJ qui utilisent mal la technologie ou qui ont négligé d’acheter légalement leur musique…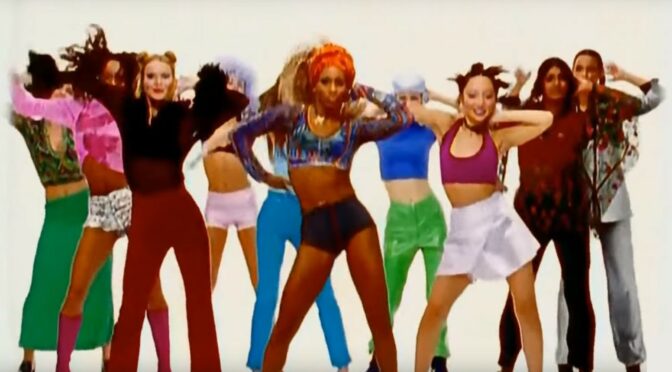
 Commençons par quelques mots pour présenter Mia Frye, danseuse et chorégraphe plus connue pour sa prestation dans le jury de l’émission Popstars ou son passage dans la ferme célébrités première du nom. Elle est née à New York en 1965 de parents américains et est arrivée en France à l’âge de 12 ans. Après plusieurs apparitions à la télévision dans les années 70 et 80 (et même une tentative de single en tant que chanteuse), elle travaille avec Luc Besson dans les années 90 (collaboration à « Nikita » et « Le 5ème élément »). Elle est en particulier l’héroïne du film « The Dancer » en 2000 (réalisé par Frederic Garson, mais produit par Luc Besson) où elle joue le rôle d’India, une danseuse muette qui éblouit son public dans des battles DJ contre danseuse. Malheureusement, cette danseuse (dans le film) connaît un refus lors d’une audition à Broadway juste parce qu’elle est muette, mais elle rencontre un scientifique qui travaillera sur un système qui permettra à India de s’exprimer librement. Mia Frye est non seulement la chorégraphe de la Macarena (on la voit danser dans le clip de Los del Rio) mais elle est aussi la chorégraphe de « Alané » de Wes la même année (on la voit aussi danser dans le clip) et de « Yakalelo » des Nomads en 1998.
Commençons par quelques mots pour présenter Mia Frye, danseuse et chorégraphe plus connue pour sa prestation dans le jury de l’émission Popstars ou son passage dans la ferme célébrités première du nom. Elle est née à New York en 1965 de parents américains et est arrivée en France à l’âge de 12 ans. Après plusieurs apparitions à la télévision dans les années 70 et 80 (et même une tentative de single en tant que chanteuse), elle travaille avec Luc Besson dans les années 90 (collaboration à « Nikita » et « Le 5ème élément »). Elle est en particulier l’héroïne du film « The Dancer » en 2000 (réalisé par Frederic Garson, mais produit par Luc Besson) où elle joue le rôle d’India, une danseuse muette qui éblouit son public dans des battles DJ contre danseuse. Malheureusement, cette danseuse (dans le film) connaît un refus lors d’une audition à Broadway juste parce qu’elle est muette, mais elle rencontre un scientifique qui travaillera sur un système qui permettra à India de s’exprimer librement. Mia Frye est non seulement la chorégraphe de la Macarena (on la voit danser dans le clip de Los del Rio) mais elle est aussi la chorégraphe de « Alané » de Wes la même année (on la voit aussi danser dans le clip) et de « Yakalelo » des Nomads en 1998.  Forte du succès des titres dont elle a chorégraphié la danse, la réputation de Mia Frye l’amène à recevoir des propositions de participation à des projets de plus grande envergure (dont le film produit par Besson en 2000). Comme je l’ai dit, en 2001, elle fait partie du jury de l’émission Popstars (du type Nouvelle Star) et par la suite devient la chorégraphe officielle du groupe de filles L5 ayant remporté cette émission de télécrochet moderne. D’ailleurs, l’expression « Happy Face ! », lancée maintes fois par Mia pour encourager les participants à l’émission est restée dans le langage courant depuis. Elle contribue aussi au film « Podium » de Yann Moix (film ayant pour sujet un sosie de Claude François) où elle se fait apostropher par « toi, avec le calamar sur la tête ! » Si vous souhaitez voir Mia Frye en action, il existe deux DVD dans le commerce. Le premier est le DVD du film « The Dancer » dont Mia est la vedette ; j’en ai parlé un peu plus haut. Le second s’appelle « Danse avec Mia Frye » et correspond à un cours de danse pour apprendre trois chorégraphies sous la direction de Mia Frye (échauffement, progression, etc.) qui ponctue ses explications d’exclamations en anglais. Le public visé est clairement les ados qui veulent apprendre quelques pas devant leur écran sans prendre de cours dans une école.
Forte du succès des titres dont elle a chorégraphié la danse, la réputation de Mia Frye l’amène à recevoir des propositions de participation à des projets de plus grande envergure (dont le film produit par Besson en 2000). Comme je l’ai dit, en 2001, elle fait partie du jury de l’émission Popstars (du type Nouvelle Star) et par la suite devient la chorégraphe officielle du groupe de filles L5 ayant remporté cette émission de télécrochet moderne. D’ailleurs, l’expression « Happy Face ! », lancée maintes fois par Mia pour encourager les participants à l’émission est restée dans le langage courant depuis. Elle contribue aussi au film « Podium » de Yann Moix (film ayant pour sujet un sosie de Claude François) où elle se fait apostropher par « toi, avec le calamar sur la tête ! » Si vous souhaitez voir Mia Frye en action, il existe deux DVD dans le commerce. Le premier est le DVD du film « The Dancer » dont Mia est la vedette ; j’en ai parlé un peu plus haut. Le second s’appelle « Danse avec Mia Frye » et correspond à un cours de danse pour apprendre trois chorégraphies sous la direction de Mia Frye (échauffement, progression, etc.) qui ponctue ses explications d’exclamations en anglais. Le public visé est clairement les ados qui veulent apprendre quelques pas devant leur écran sans prendre de cours dans une école. Parlons à présent de la Macarena, tube de l’été 1996 (classée 7 semaines numéro 1 dans le top 50). La chanson est arrivée en premier dans sa version espagnole et enregistrée par le duo Los del Rio en 1992 comme une rumba. On peut encore acheter ce titre sous la forme de compilations ou d’album single Macarena. « Macarena » est le nom donné à la jeune fille dont parle la chanson. Ce nom aurait dû être Madgalena, mais comme une chanson portait déjà ce titre, une modification a été faite pour éviter la confusion. La partie des paroles en anglais a été ajoutée en 1995 lorsque les Bayside Boys ont décidé de remixer le titre et c’est là que le succès mondial a été atteint. La chanson devient le tube de l’été 1996 en France et dans le monde entier. On voit même la fronde se monter sur Internet par le biais de sites anti-macarena (dont une bonne partie n’existe plus aujourd’hui).
Parlons à présent de la Macarena, tube de l’été 1996 (classée 7 semaines numéro 1 dans le top 50). La chanson est arrivée en premier dans sa version espagnole et enregistrée par le duo Los del Rio en 1992 comme une rumba. On peut encore acheter ce titre sous la forme de compilations ou d’album single Macarena. « Macarena » est le nom donné à la jeune fille dont parle la chanson. Ce nom aurait dû être Madgalena, mais comme une chanson portait déjà ce titre, une modification a été faite pour éviter la confusion. La partie des paroles en anglais a été ajoutée en 1995 lorsque les Bayside Boys ont décidé de remixer le titre et c’est là que le succès mondial a été atteint. La chanson devient le tube de l’été 1996 en France et dans le monde entier. On voit même la fronde se monter sur Internet par le biais de sites anti-macarena (dont une bonne partie n’existe plus aujourd’hui).  À cette époque, un autre groupe, Los del Mar (tiens, c’est proche du nom de l’autre groupe, non ?), s’est glissé dans la vague de succès envers ce titre et a sorti sa propre version de la Macarena (coupant parfois l’herbe sous le pied des Los Del Rio sur certains continents comme l’Australie). Le clip des chanteurs originaux du titre, Los del Rio, est tourné sur un fond blanc, les chanteurs Romero et Ruiz chantent alors que dix filles dansent et font une chorégraphie à répétition. L’une de ces danseuses, particulièrement reconnaissable à son turban orange, n’est nulle autre que Mia Frye, la chorégraphe des mouvements dans ce clip. Cette chorégraphie prend dès lors le nom de la chanson et « Macarena » désigne actuellement donc à la fois une chanson et la danse que l’on effectue au son de cette chanson. Un dernier mot sur la chanson avant de passer à la danse : il en existe à ce jour de nombreux remixes (officiels cautionnés par Los del Rio ou non) et il y a diverses ambiances allant de la version spécial Noël (avec les clochettes et tout et tout…) à une version style Bollywood que j’ai eu l’occasion d’entendre il y a quelques années.
À cette époque, un autre groupe, Los del Mar (tiens, c’est proche du nom de l’autre groupe, non ?), s’est glissé dans la vague de succès envers ce titre et a sorti sa propre version de la Macarena (coupant parfois l’herbe sous le pied des Los Del Rio sur certains continents comme l’Australie). Le clip des chanteurs originaux du titre, Los del Rio, est tourné sur un fond blanc, les chanteurs Romero et Ruiz chantent alors que dix filles dansent et font une chorégraphie à répétition. L’une de ces danseuses, particulièrement reconnaissable à son turban orange, n’est nulle autre que Mia Frye, la chorégraphe des mouvements dans ce clip. Cette chorégraphie prend dès lors le nom de la chanson et « Macarena » désigne actuellement donc à la fois une chanson et la danse que l’on effectue au son de cette chanson. Un dernier mot sur la chanson avant de passer à la danse : il en existe à ce jour de nombreux remixes (officiels cautionnés par Los del Rio ou non) et il y a diverses ambiances allant de la version spécial Noël (avec les clochettes et tout et tout…) à une version style Bollywood que j’ai eu l’occasion d’entendre il y a quelques années. La chorégraphie de la Macarena commence face au DJ. Tous les participants sont debout sur plusieurs lignes, pieds parallèles en léger écart et bras le long du corps. Le premier mouvement se fait sur le temps 1 de la musique.
La chorégraphie de la Macarena commence face au DJ. Tous les participants sont debout sur plusieurs lignes, pieds parallèles en léger écart et bras le long du corps. Le premier mouvement se fait sur le temps 1 de la musique. :
: Mais alors d’où vient donc cet enchaînement ? Fidèle à mon principe de vérification de mes informations, j’ai enquêté pour vous… En réalité, je n’ai pas eu besoin d’aller très loin. Le visionnage du clip de Los Del Mar où l’on trouve une version très proche de celle que je viens de détailler (mains à angle droit sur les premiers mouvements, mouvements des coudes au lieu des ondulations du bassin de la fin, etc.). Il semble que ce soit donc une version légèrement simplifiée de cet enchaînement qui soit resté dans les mémoires et, qui plus est, associé au nom de Mia Frye. Il est amusant de constater que dans le clip de Los del Mar, on peut voir une incrustation vidéo où des vacanciers en maillot de bain dansent la Macarena, mais c’est visiblement la version d’origine (temps dédoublés). Finalement, on ne peut que constater que c’est la chorégraphie du clip de Los del Rio qui subsiste, mais sur la rythmique du clip de Los del Mar… D’ailleurs, il y a une bonne idée dans ce clip concurrent de l’original en le fait de danser la Macarena à deux (la femme devant l’homme comme dans l’image arrêtée ci-contre). À ne pas faire avec un/une inconnu(e).
Mais alors d’où vient donc cet enchaînement ? Fidèle à mon principe de vérification de mes informations, j’ai enquêté pour vous… En réalité, je n’ai pas eu besoin d’aller très loin. Le visionnage du clip de Los Del Mar où l’on trouve une version très proche de celle que je viens de détailler (mains à angle droit sur les premiers mouvements, mouvements des coudes au lieu des ondulations du bassin de la fin, etc.). Il semble que ce soit donc une version légèrement simplifiée de cet enchaînement qui soit resté dans les mémoires et, qui plus est, associé au nom de Mia Frye. Il est amusant de constater que dans le clip de Los del Mar, on peut voir une incrustation vidéo où des vacanciers en maillot de bain dansent la Macarena, mais c’est visiblement la version d’origine (temps dédoublés). Finalement, on ne peut que constater que c’est la chorégraphie du clip de Los del Rio qui subsiste, mais sur la rythmique du clip de Los del Mar… D’ailleurs, il y a une bonne idée dans ce clip concurrent de l’original en le fait de danser la Macarena à deux (la femme devant l’homme comme dans l’image arrêtée ci-contre). À ne pas faire avec un/une inconnu(e).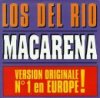 La Macarena est devenue un classique de la danse à tel point que les personnes ne sachant pas spécialement danser parlent souvent de « chorégraphie du type Macarena » pour faire référence à une danse de l’été ou une danse en ligne. D’ailleurs, on peut se demander si la chorégraphie de la Macarena n’aurait pas influencé la tecktonik (ou electro dance) dont certains mouvements ressemblent étrangement (le « peigne en arrière » par exemple). Qui aurait dit qu’il y avait tant de choses à dire sur une « simple danse de l’été » ? Pour finir, je vous laisse méditer sur cette publicité pour une bière qui a trouvé une autre origine aux mouvements de la Macarena.
La Macarena est devenue un classique de la danse à tel point que les personnes ne sachant pas spécialement danser parlent souvent de « chorégraphie du type Macarena » pour faire référence à une danse de l’été ou une danse en ligne. D’ailleurs, on peut se demander si la chorégraphie de la Macarena n’aurait pas influencé la tecktonik (ou electro dance) dont certains mouvements ressemblent étrangement (le « peigne en arrière » par exemple). Qui aurait dit qu’il y avait tant de choses à dire sur une « simple danse de l’été » ? Pour finir, je vous laisse méditer sur cette publicité pour une bière qui a trouvé une autre origine aux mouvements de la Macarena.